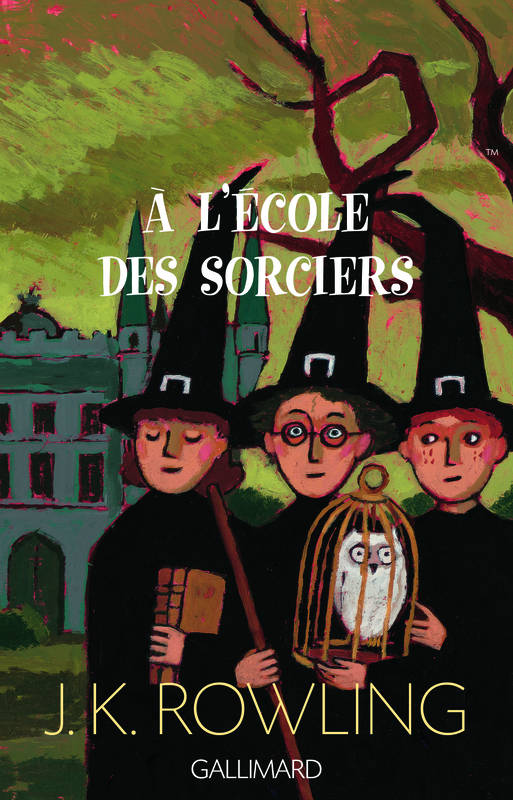Découvrez l'article de Silène Edgar intitulé, L’Histoire dans l’histoire : chasse aux sorcières, contestation sociale et anti-fascisme dans Harry Potter.
Il peut paraître étonnant de s’interroger sur la présence de l’histoire dans une œuvre pour la jeunesse résolument étiquetée comme relevant des genres de l’imaginaire. Tout un chacun sait que les sept volumes de Harry Potter transportent les lecteurs dans un univers magique et séparé du monde réel. L’œuvre de J. K. Rowling, de par son univers magique, appartient à la fantasy. Elle n’en donne cependant pas une image conventionnelle, car elle renouvelle les modèles antérieurs d’écoles de sorciers en particulier en ne coupant jamais la communication ni les passages entre le monde réel et le monde imaginaire. L’une des caractéristiques de l’œuvre est donc que cette distinction entre ces deux espaces est perméable car le héros transite de l’un à l’autre systématiquement en début et en fin de volume et que les deux sociétés, celle des Moldus et celle des sorciers, sont coexistantes. D’autre part, J. K. Rowling utilise, comme de nombreux auteurs de l’imaginaire, le biais de la magie pour évoquer le monde réel, dans ses dimensions historique et contemporaine. Les deux sont intimement associées dans l’heptalogie Harry Potter et il est impossible de dresser un état des lieux des références historiques sans les lier systématiquement au discours sociopolitique qui sous-tend ces références. C’est ce que nous allons donc explorer.
Afin de situer un peu plus précisément l’importance de cette œuvre, rappelons que si J. K. Rowling est la créatrice du personnage d’Harry Potter elle a aussi développé tout un monde qui ne cesse de s’étendre depuis la parution du premier volume de l’heptalogie en 1997. Cette œuvre est d’une grande ampleur : outre les sept volumes concernant le jeune sorcier à lunettes, trois ouvrages complémentaires, deux scénarii de film (Les Animaux fantastiques et Les Crimes de Grindelwald réalisés par David Yates, GB-USA, 2016 et 2018, qui sont supposés être suivis de trois autres dans les années qui viennent), de multiples textes courts et nouvelles qui sont diffusés sur son site Pottermore, avant d’être publiés en 2016. Depuis juin 1997, date de parution du premier tome en Grande-Bretagne, l’heptalogie a été traduite en 80 langues et s’est vendue à 500 millions d’exemplaires à travers le monde, obtenant le titre de meilleure vente de série de tous les temps. J. K. Rowling a aussi participé activement au tournage des huit films tirés de ses œuvres ainsi qu’aux deux séries télévisées adaptées de ses romans pour adultes. Dans d’autres registres, J.K. Rowling a en effet publié également un roman pour adultes, Une place à prendre (2012), et trois romans policiers sous le pseudonyme de Robert Galbraith.
Perméabilité des dimensions magiques et réelles
Les journalistes, la communauté enseignante, tout parent observant les enfants et adolescents qui dévorent de tels volumes se sont interrogés sur la capacité particulière de l’autrice à garder en haleine autant de lecteurs sur un temps si long, vingt ans de parutions successives, sept années diégétiques de la vie du héros, sans que l’intérêt fléchisse au vu des chiffres de vente mondiaux. Une des réponses expliquant cet attrait universel pour le jeune sorcier à lunettes est son substrat culturel de grande importance. L’œuvre se définit par ses multiples références à différents mythes, à des éléments de l’histoire et du monde contemporain. L’auteur a créé avec le monde des sorciers tout un univers parallèle au monde réel, imbriquant dans l’organisation de la société contemporaine un espace dont les règles et les usages sont différents. Ce qui relève de l’imaginaire dans le monde réel constitue la vérité du monde sorcier : la matière merveilleuse des contes, de la fantasy, des mythes est utilisée pour constituer un ailleurs très proche, qu’il suffit de voir pour y pénétrer. En effet, le chemin de traverse, la voie 9 ¾, le château de Poudlard, sont juste derrière le mur, au bout de la ligne de chemin de fer, si tant est qu’on y croie.
En fait, les deux mondes coexistent parfaitement, liés par un chemin sur lequel le lecteur est accompagné, aidé, aiguillé : l’humour, les redondances, les clins d’œil, les références communes le rassurent et lui donnent une impression de familiarité qui lui permet de partir à l’assaut de ce qu’il ne connaît pas, d’autres références culturelles, mythologiques, du latin, des noms à tiroirs, des thèmes qu’il voit peu souvent abordés en littérature jeunesse, la maladie, le corps, la mort surtout. Il suit des personnages, son héros tout d’abord, secondé de deux autres héros de plus en plus familiers, mais aussi la foule bigarrée des amis, des ennemis, des méchants qui ne sont pas si noirs qu’il y paraît, des gentils qui cachent des failles profondes et des erreurs de jugement. Ils sont proposés en exemple pour aider le lecteur à comprendre, loin de tout manichéisme ou moralisme, sa société, son histoire, sa culture, lui-même enfin, comme dans un miroir. Car si les livres de J. K. Rowling permettent aux lecteurs de passer de l’autre côté, comme Alice, c’est pour regarder sous un autre angle l’endroit d’où ils viennent, leur point de départ. Rowling propose une interprétation du monde actuel à travers la symbolique du monde sorcier.
Les premiers chapitres du premier volume, Harry Potter à l’école des Sorciers, pose ce postulat à travers une référence au conte de Cendrillon : Brigitte Smadja, dans un des premiers essais consacrés aux romans en France1, rapproche le personnage de Harry de Cendrillon, puisque tous deux sont les souffre-douleurs de leur mère adoptive, de leurs sœurs ou frère trop gâtés, obligés au quotidien d’effectuer des tâches ménagères harassantes, mal-nourris et empêchés d’accéder au bal, ou à l’école, qui leur permettrait d’échapper à leur condition misérable. La description de monde moldu « répond intégralement à la structure du conte de fées » tandis que « la création totalement fictive du monde des sorciers décrit […] la réalité complexe de la nature humaine »2. Le contraste entre Dudley et Harry facilite l’« effet de vie » du héros, « la réception du personnage comme personne »3. L’identification au héros n’est pas acquise d’emblée, d’autant qu’il est « maigre », défiguré par une cicatrice, mal habillé et socialement exclu : le personnage, sans être antipathique, n’attire pas l’admiration, mais crée une impression d’étrangeté (il parle au serpent), ou des effets comiques (ses cheveux repoussent seuls). Il est plutôt passif, résigné, peu confiant en lui et il fallait donc à l’autrice user d’artifices tels que cette référence au conte de fées Cendrillon : contrairement aux Dursley stéréotypés et caricaturaux, Harry apparaît normal et vivant. Ses défauts en font un bien meilleur support d’identification que son cousin grotesque et caricatural. Ce qui est réel, les Moldus, relève en fait du conte et ce qui est magique, le monde des sorciers, représente au contraire la réalité.
Avec ce premier jeu de références et de cette première inversion entre réel et imaginaire, J. K. Rowling donne la clé d’interprétation de l’œuvre dans son ensemble et nous allons donc pouvoir établir des parallèles entre fiction et histoire dans un jeu d’enquête encouragé par l’autrice, et souvent aussi confirmé par ses déclarations en interview et sur son site Pottermore. La multiplicité des personnages permet d’aborder des questions sociologiques et historiques d’importance. La relecture attentive, qui est encouragée par ce foisonnement, est l’occasion de découvrir des sens cachés : le lecteur est amené à devenir actif et à creuser le texte.

Chasse aux sorcières et nazisme dans le monde sorcier.
Le fascisme, le nazisme en particulier, mais aussi de manière plus large tout régime autoritaire, sont condamnés de manière assez lisible dans les différents volumes. Les éléments concernant la chasse aux sorcières sont plus diffus, tandis que les références au passé politique et historique de la Grande-Bretagne sont concentrées sur certains personnages.
La chasse aux sorcières
Dolorès Ombrage rappelle l’inquisition mais aussi la chasse aux sorcières du sénateur Mac Carthy aux États-Unis dans les années 60, s’attaquant à ceux qui réfléchissent différemment, ceux qui s’intéressent à l’histoire.
La chasse aux sorcières est un élément diffus de la série des Harry Potter ; quelques références précises apparaissent de façon éparse et très codée : Florian Fortarôme, apparu dans le tome 3, « qui savait beaucoup de choses sur les chasses aux sorcières du Moyen Âge4 », est arrêté dans le tome 6 par les Mangemorts, sans raison apparente si ce n’est justement cette connaissance de l’histoire :
Emmené de force à en juger par l’état de sa boutique.
— Pourquoi ?
— Qui sait ? C’est un homme bien, Florian. Il a dû leur déplaire.5
Ce détail significatif, dont l’interprétation n’est accessible qu’aux lecteurs très attentifs se rappelant le tome 3 lors de la lecture du tome 6, est caractéristique du travail de J. K. Rowling. Elle prête attention à chaque nom propre, tisse des références multiples et cache des clés de compréhension dans cette infinité de petits éléments qu’elle engage à décrypter. Ainsi, Cornelius Agrippa apparaît dès le tome 1, sur une carte de chocogrenouille, ces friandises accompagnées de photographies de sorciers célèbres. Or cet alchimiste allemand est justement une des victimes des chasses aux sorcières médiévales puisqu’il a été condamné à cause de ses écrits sur la magie et les sorciers6.
Le nazisme
Les nombreuses références au nazisme ne sont pas difficiles à identifier pour le lecteur de Rowling, tant il est habitué à la spéculation proposée dont l’autrice lui a donné l’habitude à travers l’onomastique et la relecture des mythes.
Bien d’autres avant nous ont relevé ces éléments dont voici une énumération rapide : les initiales du fondateur de Serpentard – Salazar de son prénom, en référence au dictateur portugais ami d’Hitler –, mais aussi de Rogue – Severus Snape dans sa version originale – sont S.S. La théorie de la race, la doctrine prônant la pureté ethnique, le physique aryen des Malefoy, les sonorités de l’école Durmstrang, qui rappellent le Sturm und Drang, mouvement préromantique allemand qui aurait été apprécié du gouvernement nazi, le fait que cette école n’accepte que les sorciers de sang-pur, la marque de la mort, elle-même, comme un étendard portant la croix gammée, les exemples sont nombreux. Par l’intermédiaire de son site web, l’autrice anglaise a déclaré que les expressions « sang-pur », « sang-mêlé » et « né-Moldu » figurant dans les Harry Potter se comparaient à « certains des chartes réelles dont les nazis se servaient pour montrer ce qui constituait du sang “aryen” ou “juif”7.
J’en ai vu un au Musée de l’holocauste à Washington après avoir conçu les définitions de “sang-pur”, de “sang-mêlé” et de “né-Moldu” et ai été frappée de voir que les nazis appliquaient exactement la même logique tordue que les Mangemorts. Selon leur propagande, il suffisait qu’un grand-parent soit juif pour “contaminer” le sang.8
Rappelons que, dans le septième volume, l’épisode du combat final entre Dumbledore et Grindelwald a eu lieu symboliquement en 1945, après « cinq années de troubles, de morts, de disparitions ». Le parallèle avec le nazisme est donc très fort et supposerait que Voldemort soit un néo-nazi. Des développements autour de cette période vont sans doute être intégrés aux scénarii des Animaux fantastiques.
Cependant, l’autrice ne focalise pas toutes ses références sur le seul nazisme. Celles-ci sont aussi parfois à lire au regard de l’histoire britannique : J. K. Rowling a confirmé ainsi un parallèle à faire entre Fudge et Chamberlain, connu pour ne pas avoir pris la mesure de la montée du nazisme quand, Scrimgeour/Churchill a, lui, agi avec poigne. J. K. Rowling ne semble pas accuser Chamberlain de collaborationnisme, puisqu’il représente au contraire un certain renouveau dans l’histoire britannique après l’abdication d’Édouard VIII, due à ses accointances avec le régime nazi, mais elle dénonce son aveuglement. Le personnage de Scrimgeour, représentant Churchill dans le monde sorcier, est cependant aussi vivement critiqué par le personnage d’Harry Potter, qui s’offusque de l’arrestation symbolique, mais injuste, de Stan Rocade. J. K. Rowling, interrogée sur le sujet, indique :
J’ai toujours prévu que ce genre de choses arriverait, mais cela a une très forte résonance, vu que je crois, avec de nombreux autres, qu’il y a eu des cas où l’on a persécuté des gens qui ne méritaient pas de l’être, même lorsque nous essayions de trouver ceux qui avaient commis des atrocités absolues. Ces choses arrivent, c’est la nature humaine. Il y avait des parallèles très surprenants entre mes romans et notre époque au moment où j’écrivais.9
Dans le propos de Potter, le manque de clairvoyance de Fudge n’excuse donc en rien celui du nouveau gouvernement et il apparaît qu’une lecture de ces références historiques ne peut se résumer à la critique des régimes autoritaires d’Hitler et Staline.
L’épisode de la tante Marge, dans Le Prisonnier d’Azkaban, confirme notre idée d’un projet de critique sociopolitique plus vaste, et sans doute préexistante à la volonté de référer au nazisme qui apparaît plus tardivement dans la série. Cette femme est associée par son prénom et son apparence à Margaret Thatcher et J. K. Rowling a indiqué que c’était bien un fait voulu ; l’autrice fait tenir à cette figure historique un discours suprémaciste, constitué d’un mélange de haine des « bons à rien », des « chômeurs », et de propos sur la race qui préfigurent ceux de Dolorès Ombrage sur les « hybrides ». D’autres références à des mouvements racistes ou à des dictatures sont lisibles dans le mouvement de Voldemort : les cagoules des Mangemorts et les traques de nés-Moldus en fuite rappellent tristement les tenues et les chasses aux esclaves du Ku Klux Klan dès le début du quatrième tome, Harry Potter et la coupe de feu. Durmstrang est sous la direction d’un Karkaroff criminel faussement repenti, rappelant pour sa part la dictature stalinienne.
Ces propos de J. K. Rowling assoient l’hypothèse selon laquelle elle avait une volonté de dépeindre plus largement les manifestations des politiques suprémacistes dans l’histoire :
Eh bien, c’est une métaphore politique, mais à aucun moment je ne me suis dit que je voulais recréer l’Allemagne nazie dans le monde des sorciers. En fait, même si j’ai volontairement évoqué l’Allemagne nazie, il y existe aussi d’autres associations avec des situations politiques différentes. Je ne peux donc pas en désigner une seule en particulier.10
De la critique du nazisme à celle de l’aristocratie
Derrière la dénonciation du fascisme transparaît une critique sociale de l’aristocratie et d’un discours encore actif dans la société britannique sur la prééminence du sang noble.
Effectuons un léger détour pour observer les parallèles entre régime fasciste et régime aristocratique dans l’heptalogie : J. K. Rowling a souvent fait part de son admiration pour l’autrice Jessica Mitford, connue pour son engagement anti-fasciste durant l’entre-deux guerres. Elle la considère comme son héroïne et l’écrivaine qui l’a le plus influencée. Deux autres des sœurs Mitford, une grande famille d’aristocrates, sont connues aussi, mais comme fascistes et alliées d’Hitler, car elles ont été impliquées dans la collaboration entre le dictateur allemand et le roi Édouard VIII, comme le rappelle J. K. Rowling dans une interview pour The Telegraph11. Unity, amie intime d’Hitler, a même tenté de se suicider lorsque son pays a déclaré la guerre à l’Allemagne. Pour la petite histoire, elle est connue pour avoir eu un serpent pour animal domestique, à l’instar de Voldemort avec son serpent Nagini. Au contraire de ses sœurs, Jessica Mitford était une femme de gauche membre du Parti Communiste. Elle a épousé le neveu de Churchill, un aviateur mort durant la seconde guerre mondiale avant d’émigrer aux États-Unis où elle a combattu pour les droits des noirs avec son second époux, syndicaliste.
Un parallèle apparaît donc entre l’histoire des extravagantes sœurs Mitford et les membres de la famille Black : de la même façon que les sœurs Mitford ont pris des voies politiques opposées, Bellatrix Lestrange, née Black et sa sœur, Narcissa Malefoy collaborent pendant des années avec Voldemort et les Mangemorts, tandis que la troisième sœur, Andromeda Tonks, a choisi la résistance aux côtés de l’Ordre du Phénix. Sa fille, Nymphadora, meurt au combat, aux côtés de son époux Remus Lupin, dans le dernier volume. C’est le parallèle entre les Black et les Mitford qui permet de comprendre que J. K. Rowling dénonce bien plus que cette collaboration avec les nazis, lorsqu’Harry interroge son parrain sur les idées politiques de la famille Black. Sirius Black, le fils maudit, montre que sa famille n’a pas attendu que Voldemort arrive pour véhiculer des thèses suprémacistes. Dans L’Ordre du Phénix, Sirius explique que leur devise est « Toujours pur », en français dans le texte, et que leur famille remonte au Moyen Âge, ce qui laisse supposer que le racisme et les idées politiques de la famille ont largement précédé l’avènement de Voldemort. De même, le fantôme de Phineas Nigellus Black, pourtant mort en 1925, donc bien avant la naissance de Tom Jedusor, exprime son adhésion aux thèses anti-Moldus lorsqu’il traite Hermione de « sang-de-bourbe ». Cela assoit l’idée que le suprémacisme est ancien dans la famille et ne date pas de l’après-guerre. Les Black ne se sont d’ailleurs pas engagés formellement dans la milice de Voldemort :
— Et tes… tes parents aussi étaient des Mangemorts ?
— Non, non, mais crois-moi, ils approuvaient les idées de Voldemort, ils étaient tous partisans de purifier la race des sorciers, de se débarrasser de ceux qui venaient de familles moldues et de mettre les sang-pur au pouvoir. Mais au début, quand il s’est engagé, je suis sûr que mes parents voyaient en Regulus un brave petit héros…12
Cela correspond aussi aux idées de la famille de Voldemort, les Gaunt, une autre famille de « grande noblesse » quoique désargentée, comme l’exprime Marvolo Gaunt, le grand-père du sorcier maléfique en parlant des amours de sa fille : « Ma propre fille, une descendante au sang pur de Salazar Serpentard, courant après un répugnant Moldu aux veines souillées ? »13
Il apparaît donc que le sorcier maléfique n’a pas développé ses théories sur la pureté du sang : il en a hérité et ces discours sont ceux de l’aristocratie. Cette mise en perspective au travers du parallèle Black/Mitford replace donc les références au nazisme dans le cadre plus large d’une critique globale du suprémacisme, comme le confirme l’autrice dans ces propos :
Je voulais qu’Harry quitte le monde des Moldus et retrouve exactement les mêmes problèmes dans l’univers des sorciers. On y retrouve donc cette volonté d’imposer une hiérarchie, accentuée par les notions de fanatisme et de pureté de la race, qui sont de graves erreurs mais qui se manifestent dans le monde entier. Les gens aiment se croire supérieurs et s’enorgueillissent d’une pureté apparente, à défaut d’autre chose. »14

Un mépris de classe
À la notion de race s’ajoute la question de la classe sociale. Rowling peint la société britannique dans sa diversité sociale et financière, dépassant le problème du racisme pour aborder celui de la lutte des classes. Le suprémacisme affiché par les aristocrates « pure-blood » n’est pas séparable de la notion de classe sociale, car si ce sont exclusivement les familles anciennes et riches de « sang-pur » qui sont les plus ferventes supportrices de Voldemort, toutes les anciennes familles ne lui sont pas fidèles : certaines entrent dans une catégorie que les « pure-blood » appellent les « traîtres à leur sang ». Ces familles se caractérisent par leurs choix politiques, mais aussi par leur classe sociale, car ils sont pauvres, de façon uniforme ; Rowling donne plusieurs exemples plutôt qu’un pour installer le tableau socio-économique : la famille Malefoy, la famille Gaunt, la famille Black, mais aussi les Croupton et les Smith (la sorcière descendante de Helga Poufsouffle) sont du côté des Mangemorts tandis que la famille « traître à son sang », la famille Weasley, est secondée par les familles Lovegood et Londubat, peu argentées elles aussi, au vu de l’accoutrement de la grand-mère Londubat – une fourrure de renard mangée aux mites et un chapeau orné d’un vautour empaillé – et de la maison de bric et de broc des Lovegood.
Dans le contexte du collège, avant même que les thèses suprémacistes soient exprimées clairement par les protagonistes, Draco et les Serpentards représentent les riches élèves d’écoles comme Eton, de famille noble, tandis que les Weasley émergent de la classe populaire, au même titre que Stan Rocade par exemple. Le cycle est à considérer comme un exemple de school story, où ce type de distinction sociale est un ressort dramatique courant. Ron est marqué par la pauvreté de sa famille, qui semble correspondre au stéréotype de la famille irlandaise populeuse. Sa maison est aussi pauvre que celle des Lovegood et, si elle enchante Harry, elle est pour Ron un signe déshonorant de leur manque d’argent. Drago Malefoy souligne son mépris de classe lors de sa première rencontre avec lui : « Mon nom te fait rire ? Inutile de te demander le tien. Mon père m’a dit que tous les Weasley ont les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d’enfants pour pouvoir les nourrir. »15
C’est un moment essentiel puisqu’Harry Potter, lui-même issu d’une famille de « pure-blood », quoique sa mère soit née-moldue, et auréolé de gloire, va prendre parti pour Ron. Peu après, alors que sa classe sociale le prédestine à entrer chez les Serpentard, il choisit volontairement les Gryffondor où se côtoient des élèves de différentes extractions sociales : Harry s’inscrit d’emblée, comme son père et son parrain, dans la contestation sociale.
Le parler populaire, que la traduction a effacé, désigne aussi Hagrid comme membre de la classe ouvrière, victime de la haine ancienne de Tom Jedusor lorsqu’il était élève et de l’acharnement de Malefoy lorsqu’il devient professeur : celui-ci essaie de le faire exclure de nouveau, avec le soutien du ministre Fudge qui sort d’une neutralité apparente pour apparaître dès lors comme soutenant les familles aristocrates. Au sein même des partisans de Voldemort, les nobles méprisent ouvertement certains de leurs alliés à cause de leur rang social : Rogue lui aussi fait partie de ces classes laborieuses, comme en témoigne ce passage du tome 6, qui fait saillir le mépris des « pure-blood » pour ses origines sociales. La scène d’ouverture montre les sœurs Black rendre visite à Rogue et la haine de Bellatrix est expliquée alors non seulement par les doutes qu’elle a envers l’intégrité de son allié, mais aussi par sa condition de sang-mêlé :
Elles regardèrent les interminables rangées de maisons délabrées aux murs de brique qui s’étendaient devant elles, leurs fenêtres éteintes, aveugles dans l’obscurité.
— C’est ici qu’il habite ? demanda Bellatrix d’un ton méprisant. Ici ? Dans ce trou de Moldus ? Nous devons être les premières de notre rang à avoir jamais mis les pieds dans...16
Interrogée dans la presse sur cette volonté de dénoncer les distinctions de classe sociale, Rowling a répondu :
L’enfant a une conscience aiguë de l’argent avant d’être conscient des classes. Il ne va pas vraiment remarquer comment un autre enfant tient son couteau et sa fourchette, mais il va être bien conscient de ne pas avoir d’argent de poche ou de ne pas en avoir tant que ça. Je me revois à l’âge de 11 ans. Les enfants peuvent être méchants, très méchants. C’est ainsi qu’on a Ron qui ne porte pas de robes de la bonne longueur, vous savez, qui ne peut pas s’acheter des choses dans le train. Il doit se contenter des sandwichs que sa mère lui a faits, même s’il ne les aime pas. Avoir assez d’argent pour s’intégrer est une facette importante de la vie, et qu’est-ce qu’il y a de plus conformiste qu’une école ?17

Des références historiques au service d’un discours sociopolitique
J. K. Rowling se sert donc de ses personnages pour incarner ses idées sur la politique et l’histoire de son pays, mais aussi sur son organisation sociale. Dans notre tour d’horizon, last but not the least, Hermione Granger est elle aussi un personnage permettant de souligner les failles du système aristocratique dans le monde sorcier. Déconsidérée aux yeux des « pure-blood » ou aristocrates, par son statut de née-moldue, c’est-à-dire roturière, elle contrecarre leur mépris par son talent, ses capacités exceptionnelles et sa maîtrise des sorts et enchantements.
Certains sorciers, la famille Malefoy, par exemple, sont persuadés qu’ils valent beaucoup mieux que les autres parce qu’ils ont ce qu’on appelle un sang pur. Les autres sorciers savent bien que ça n’a aucune importance. Regardez Neville Londubat, par exemple, il vient d’une famille au sang pur, mais c’est tout juste s’il arrive à faire tenir un chaudron debout.
— Et ils n’ont jamais inventé un sortilège qu’Hermione soit incapable de refaire, dit fièrement Hagrid.18
Déjà Lily Potter, elle-même née-moldue, comme le fait remarquer Harry au professeur Slughorn dans le sixième tome, excellait en tous points quoiqu’elle ne soit pas née dans une grande famille. Alors que les « pure-blood », Ron, Neville, Draco, sont assez moyennement doués en enchantements, potions et sortilèges, Hermione et Lily sont des élèves excellentes, preuve par l’exemple que les nés-Moldus sont aussi talentueux que les autres et qu’ils sont nécessaires à la continuation du monde des sorciers. J. K. Rowling énonce d’ailleurs un fait simple, admis universellement, sur les dangers de la consanguinité, et elle le fait dire de façon limpide à Ron, le futur compagnon d’Hermione, qu’il protège avec un esprit chevaleresque, dès la première des attaques de Malefoy, quitte à cracher des limaces : « — De toute façon... la plupart des sorciers ont du sang Moldu dans les veines. Si nous n’avions jamais épousé de Moldus, il y a longtemps que nous aurions disparu. »19
Rowling s’appuie sur cette critique sociétale pour démontrer ses idées politiques pour l’avenir : pour elle, l’intégration de personnes d’autres cultures ou d’autres nations apportent un renouveau salutaire dans les sociétés vieillissantes. Et, forte de sa différence, Hermione est ainsi la première, parfois la seule, à comprendre les autres victimes du rejet : les elfes, les centaures, les gobelins, les géants, etc. Elle a conscience, malgré sa naissance moldue, de l’erreur dans laquelle est encore la société des sorciers aujourd’hui, suivant en cette opinion son maître, Dumbledore : « Nous, les sorciers, avons maltraité trop longtemps les êtres qui nous sont proches et nous récoltons aujourd’hui ce que nous avons semé. »20
Personnage essentiel pour sa créatrice, Hermione représente la prise de conscience, mais aussi le renouveau et sans doute l’espoir que la société britannique évolue.

Conclusion : Projet politique
« Contre quoi tous mes livres prêchent-ils ? Le sectarisme, la violence, les luttes de pouvoir et tout le reste. »21 Les valeurs défendues ici par l’autrice trouvent écho d’autant plus facilement chez les lecteurs que les parallèles fonctionnent dans toutes les cultures, puisque chacune possède ses minorités et que l’histoire britannique trouve écho dans de nombreuses autres situations politiques du passé et du présent. J. K. Rowling ne crée cependant pas une œuvre moraliste : « Et contrairement à Lewis, dont les livres sont imprégnés de théologie, Rowling refuse de se considérer comme une éducatrice morale auprès des millions d’enfants qui lisent ses livres. »22 Elle-même affirme : « Je ne voulais vraiment pas faire de la morale, même si je pense que ce sont des livres moraux. »23
En effet, la précision d’horloger de J. K. Rowling lui permet d’affiner et de contrebalancer ses « vérités » pour éviter le manichéisme, la démagogie ou la morale. Ce qu’il ressort en fin de compte est qu’Hermione, allégorie de la minorité rejetée, n’est pas une victime résignée et qu’elle porte avec elle l’espoir d’un changement : dans le dernier chapitre de l’heptalogie, alors qu’elle est devenue adulte, elle entre au gouvernement pour faire valoir ses idées et faire évoluer le monde sorcier.
Après Poudlard, Hermione a commencé sa carrière au Département de contrôle et de régulation des créatures magiques, où elle a contribué à améliorer considérablement la vie des elfes de maison et de leurs semblables. Elle est passée ensuite au Département de la justice magique, où elle a aidé, par ses idées progressistes, à faire abolir les lois oppressives favorables aux sangs-purs.24
Si Rowling admet qu’il « y a un certain degré de politique dans Harry Potter », elle pense cependant « que chaque lecteur voit avec ses lunettes. Les gens qui envoient leurs enfants au pensionnat semblent croire que je suis de leur côté, ce qui n’est pas le cas. Les wiccans pratiquants pensent que je suis aussi une sorcière, alors que je ne le suis pas. » Pour notre part, nous espérons bien qu’elle est une sorcière puisque, dans son univers, seuls les sorciers réfléchissent !
Notes :
1 Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, Paris, PUF, Sociologies d’aujourd’hui, 2001
2 Ibid., p. 9.
3 Ibid., p. 11.
4 Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, coll. « Folio Junior », 2000, p. 60.
5 Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2005, p. 121.
6 Harry Potter à l’école des sorciers, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 1999, p. 82.
7 « the real charts the Nazis used to show what constituted “Aryan” or “Jewish” blood. » FAQ du site officiel de J. K. Rowling. Consultée le 5/02/2019, traduction par l’autrice de l’article
8 « I saw one in the Holocaust Museum in Washington when I had already devised the “pure-blood”, “half-blood” and “Muggle-born” definitions, and was chilled to see that the Nazis used precisely the same warped logic as the Death Eaters. A single Jewish grandparent “polluted” the blood, according to their propaganda. » Ibidem.
9 « I always planned that these kinds of things would happen, but these have very powerful resonances, given that I believe, and many people believe, that there have been instances of persecution of people who did not deserve to be persecuted, even while we’re attempting to find the people who have committed utter atrocities. These things just happen, it’s human nature. There were some very startling parallels at the time I was writing it. »
http://www.accio-quote.org/articles/2005/0705-tlc_mugglenet-anelli-2.htm
10 « Well, it is a political metaphor. But… I didn’t sit down and think, “I want to recreate Nazi Germany” in the wizarding world. Because although there are quite consciously overtones of Nazi Germany, there are also associations with other political situations. So I can’t really single one out. », Meredith Vieira, Harry Potter: The final chapter, MSNBC, 30 juillet 2007. (traduction par l’autrice de l’article)
11 J. K. Rowling, « The First It Girl [archive] », The Telegraph, 26 novembre 1006.
12 Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2005, p. 131.
13 Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2005, p. 235.
14 Entretien au Carnegie Hall. Archivé sur http://www.the-leaky-cauldron.org/2007/10/20/j-k-rowling-at-carnegie-hall-reveals-dumbledore-is-gay-neville-marries-hannah-abbott-and-scores-more/ (traduction de l’autrice de l’article).
15 Harry Potter à l’école des sorciers, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 1999, p. 87.
16 Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2005, p. 29.
17 « Kids are acutely aware of money—before they’re aware of class. A kid isn’t really going to notice how another kid holds his knife and fork. But a kid will be acutely aware that he doesn’t have pocket money. Or that he doesn’t have as much pocket money. I think back to myself at 11. Kids can be mean, very mean. So it was there in Ron not having the proper length robes, you know? And not being able to buy stuff on the trolley. He’s got to have sandwiches his mum made for him, even though he doesn’t like the sandwiches. Having enough money to fit in is an important facet of life—and what is more conformist than a school ? », « J. K. Rowling’s Books That Made a Difference », O, The Oprah Magazine, janvier 2001, traduction de l’autrice de l’article.
18 Harry Potter et la Chambre des Secrets, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 1999, p. 95-96.
19 Ibid.
20 Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2005, p. 936.
21 Nancy Gibbs, « Runners-up J. K. Rowling », Time, 19 décembre 2007, traduction de l’autrice de l’article.
22 « And unlike Lewis, whose books are drenched in theology, Rowling refuses to view herself as a moral educator to the millions of children who read her books. », Lev Grossman, « J. K. Rowling Hogwarts And All », Time 166, 2005, traduction de l’autrice de l’article.
23 J. K. Rowling, Interview Barnes & Noble, 19 mars 1999.
24 Webchat avec J. K. Rowling, 30 juillet 2007 Archivé le 25 mai 2007 : https://web.archive.org/web/20070525033940/http://www.bloomsbury.com/jkrevent/, traduction de l’autrice de l’article.
Bibliographie :
Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 1997. Harry Potter à l’école des sorciers, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 1999.
Harry Potter and the Chamber of Secrets, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 1998. Harry Potter et la Chambre des Secrets, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 1999.
Harry Potter and the Prisoner of Askaban, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 1999. Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, coll. « Folio Junior », 2000.
Harry Potter and the Goblet of Fire, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 2000. Harry Potter et la Coupe de feu, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2000.
Harry Potter and the Order of the Phenix, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 2003. Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2003.
Harry Potter and the Half-Blood Prince, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 2005. Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2005.
Harry Potter and the Deathly Hallows, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 2007. Harry Potter et les Reliques de la Mort, Paris, Gallimard, tr. Jean-François Ménard, 2007.
Bibliographie critique :
Marianne Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie, Paris, Ellipses, 2013.
Valérie Charbonniaud-Doussaud, Harry Potter, la magie d’une écriture, Michel Houdiard éditeur, Paris, 2012.
François Comba, Profondeur de champs, série d’articles, [en ligne], consultée le 28 août 2014.
Eliza T. Dresang, « Hermione Granger and the heritage in gender », dans L.A. Whited (dir.) The Ivory Tower and Harry Potter, Perspectives on a Literary Phenomenon, Columbia, University of Missouri Press., 2002.
Lev Grossman, « J. K. Rowling Hogwarts And All », Time n° 166, 2005
J. C. Milner, À l’école des sciences politiques et morales, Paris, PUF, 2014.
Carole Mulliez, Les Langages de Harry Potter, thèse de doctorat, sous la direction de François Gallix, Paris IV, Sorbonne, soutenue le 21 mars 2009.
Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, Paris, PUF, Sociologies d’aujourd’hui, 2001.