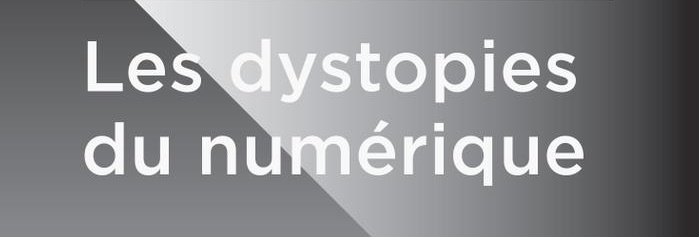A l'occasion de la sortie le 15 mai des Dystopies du numérique aux éditions Actusf, Marc Atallah revient sur ce nouvel ouvrage publié dans la série « Les Collections de la Maison d’Ailleurs ».
Les Dystopies du numérique a co-écrit avec Frédéric Jaccaud.
Actusf : Les Dystopies du numérique est un recueil de deux essais paru dernièrement aux éditions Actusf. Quelle a été l’idée à l’origine de cet ouvrage ?
Marc Atallah : Depuis 2013, les ouvrages de la série « Les Collections de la Maison d’Ailleurs » sont toujours publiés à l’occasion de la nouvelle exposition du musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires. Les Dystopies du numérique ne fait pas exception à la règle, puisqu’il a été imaginé par Frédéric Jaccaud et moi pour accompagner l’exposition « Mondes (im)parfaits. Autour des Cités obscures de Schuiten et Peeters », un projet qui a débuté le 16 novembre 2019 et qui se finira le 25 octobre 2020. Cette exposition, comme son titre le laisse entendre, traite des relations entre utopie et dystopie, réfléchies au travers des œuvres originales de François Schuiten et Benoît Peeters, ainsi que celles de trois artistes suisses (Sébastien Mettraux, Thomas Crausaz et Louis Loup Collet). Au moment de planifier les publications, il nous a paru intéressant, à Fred et moi, de proposer une réflexion centrée non pas sur le genre de la dystopie in extenso – le catalogue de l’exposition était davantage concerné par cette question –, mais sur des récits de science-fiction, plus récents, thématisant, via le mode dystopique, les problématiques aliénantes issues de la société numérique. C’était une façon à mon avis assez élégante d’intégrer dans une même analyse les romans cyberpunks et post-cyberpunks, mais aussi les enquêtes qui relevaient de la philosophie de la cybernétique et de l’anthropologie du corps contemporain.

Actusf : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur son contenu ?
Marc Atallah : Le livret est composé de deux essais : le premier, écrit par mes soins, propose de réfléchir, d’une part, à la relation consubstantielle unissant les utopies et les dystopies (l’analyse sémiotique montre que les utopies sont structurellement identiques aux dystopies) ; et, d’autre part, aux propriétés utopiques de la cybernétique, ces mêmes propriétés qui, une fois mises en récit, vont révéler leur composante dystopique. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer que tout un pan du paradigme cybernétique n’est pas scientifique mais intègre des postulats à la fois réducteurs et utopiques ; et que, comme c’est souvent le cas en science-fiction, des auteurs se sont ingéniés à faire vivre des femmes et des hommes dans un monde basé sur l’utopie cybernétique, afin d’en pointer les déviances aliénantes. Quant au second essai, écrit par Fred, le conservateur de la Maison d’Ailleurs, il s’attache à étudier en détail certains récits de science-fiction qui intègrent à leurs intrigues des mondes simulés, en particulier numériques : son enquête montre comment les textes peuvent, parfois de manière ambiguë, dénoncer ou problématiser les impacts socio-anthropologiques du pouvoir digital.
Actusf : Pensez-vous que les relations humain/numérique vont encore évoluer ?
Marc Atallah : (Rires !) Cela me paraît étrange d’imaginer l’inverse, tant les pistes de développement esquissées sont nombreuses : assistant virtuel, puces sous-cutanées, e-commerce (et e-book), télétravail, dématérialisation de l’information, optimisation des coûts, industrie vidéoludique… Les avancées technologiques combinées avec la puissance des grands groupes américains (GAFAM) laissent, par exemple, augurer une société où de plus en plus d’échanges seront confiés aux agents numériques ainsi qu’une société où la trace – et son corollaire : le contrôle – auront remplacé le mouvement, pour reprendre les mots de Damasio. L’épisode COVID-19 a d’ailleurs montré comment le monde numérique avait encore de beaux jours devant lui, mais a aussi exhibé certaines des peurs qui lui sont associées, telles que la peur de la traçabilité, des applications de contrôle, de la standardisation des opinions, et j’en passe. Le XXIe siècle sera religieux, pour faire un clin d’œil à Malraux, digitalement religieux.
Actusf : Selon vous, y-a-t-il des limites à poser ? L’humain pourrait-il disparaître au profit du numérique ?
Marc Atallah : Je ne crois pas à la disparition de l’humain par un agent externe : nous sommes déjà bien assez forts pour nous faire disparaître nous-mêmes sans avoir à convoquer quelque chose d’autre. Par contre, il est clair que nous avons la faculté incroyable de nous aliéner à nos outils, comme l’analysait Günther Anders dans son célèbre L’Obsolescence de l’homme, et, ce faisant, à nous « machiniser », voire à nous « numériser ». Je n’entends pas par là une transformation ontologique de l’homme – en machine, en faisceaux de photons –, mais une adaptation de notre agir et de nos pensées aux référentiels machinique et digital. C’est d’ailleurs exactement là où la science-fiction ne s’est pas trompée : en utilisant les métaphores du robot, du cyborg ou de l’IA, elle pointe notre tendance à imiter, même si ça nous est mortifère, les modes d’être de la machine industrielle (robot), de la dépendance à la technologie (cyborg) ou de « l’adieu au corps » (IA), pour évoquer le titre d’un essai de David Le Breton (L’Adieu au corps).
-300x460.jpg)
Actusf : Comment en êtes-vous venu à collaborer ? Qu’est-ce qui vous intéressait dans cette démarche ?
Marc Atallah : En fait, Fred et moi travaillons tous les jours ensemble, puisque je dirige la Maison d’Ailleurs et qu’il en est le conservateur ! La collaboration est donc à la fois naturelle – nous avons œuvré de concert dès le premier numéro des « Collections de la Maison d’Ailleurs » – et légitimée par notre envie de diffuser l’expertise du musée, une expertise appuyée sur la richesse de nos collections, les plus grandes d’Europe sur la science-fiction et les mondes fictionnels alternatifs. Il s’avère qu’avec les années, je me suis rendu compte de la complémentarité de nos approches : nous avons des conceptions de la science-fiction relativement proches, mais suffisamment nuancées pour que nos propos soient complémentaires.
Actusf : Les Dystopies du numérique est l’un des livrets des Collections de la Maison d’Ailleurs. Pourquoi ces fascicules de vulgarisation en lieu et place des catalogues habituels ?
Marc Atallah : En fait, ces livrets ne remplacent pas les catalogues habituels ! À chaque exposition ou presque, nous produisons un catalogue et un livret : le catalogue est plus coûteux, plus vaste et plus orienté sur les artistes ; il m’était cher, en 2013, de pouvoir proposer au public du musée un ouvrage bon marché, plus ciblé et traitant de la thématique de l’exposition en cours. Voici l’acte de naissance des « Collections de la Maison d’Ailleurs » : une série de petits ouvrages illustrés par nos collections permettant de saisir ce qui était au cœur de nos expositions, même si, parfois, cette thématique était explicitement peu présente dans le musée. Les Dystopies du numérique en est un parfait exemple : l’exposition « Mondes (im)parfaits » et son catalogue traitent des relations entre utopie et dystopie, sans attribuer une place particulière aux dystopies du numérique, alors que le livret édité par ActuSF se focalise exclusivement sur celles-ci. Deux ouvrages complémentaires, donc.

Actusf : 10 numéros sont parus dans Les Collections de la Maison d’Ailleurs. Avec le recul, que pensez-vous de cette collection ? Changeriez-vous quelque chose ? Comment la voyez-vous évoluer ?
Marc Atallah : Je suis très content de cette collection, surtout qu’au début, on ne savait pas vraiment où nous allions ! Il m’arrive, parfois, de m’amuser à regarder les dix livrets côte-à-côte, et de les feuilleter pour constater le parcours accompli : je trouve que l’on a fait du bon travail et que l’on a bien réussi, d’une part, à diffuser l’âme de la Maison d’Ailleurs et, d’autre part, à faire connaître la diversité de nos collections. On a traité de dix thématiques fondamentales, on a eu la chance de collaborer avec plusieurs spécialistes, on a toujours réussi à garder cette alliance fondamentale entre iconographie choisie précisément et texte à destination du grand public – même si certains ouvrages sont plus complexes que d’autres. Avant de penser au futur, j’aimerais bien que l’on puisse produire un coffret : je suis convaincu que pas mal de lecteurs seraient intéressés par une telle opportunité, surtout que certains volumes sont devenus introuvables… Pour la suite, je ne sais pas : peut-être changer le design (assez sobre à dessein), ou alors être en mesure d’en produire deux par expositions, vu que chaque projet de la Maison d’Ailleurs pourrait donner lieu à cinq ou six livrets !
Actusf : La Maison d’Ailleurs vient de rouvrir ses portes. Malgré l’actualité, que pouvons-nous y découvrir ? Quels sont les projets à venir ?
Marc Atallah : Comme je l’ai dit plus haut, nous présentons jusqu’au 25 octobre 2020 l’exposition « Mondes (im)parfaits. Autour des Cités obscures de Schuiten et Peeters » : on peut y voir les planches originales de François Schuiten, l’œuvre multimédia de Sébastien Mettraux – réalisée en dialogue avec une des images de François –, la randonnée dystopique inventée par Thomas Crausaz et les dessins utopiques de Louis Loup Collet. Mais on peut surtout y découvrir une réflexion, relativement inédite dans le monde des musées il me semble, à propos des relations qui se tissent entre les utopies et les dystopies. Autrement dit, c’est une exposition qui cherche à réconcilier utopie et dystopie, et de montrer à quoi peuvent « servir » ces récits ; on montre en particulier – et les œuvres d’art servent d’échos signifiants à cette démonstration – que les utopies sont à l’écoute des dysfonctionnements du monde réel, alors que les dystopies mettent en intrigue les dysfonctionnements des utopies nichées au creux de nos idéologies.
Actusf : Quel serait le roman incontournable, qui traite de ces problématiques, que vous conseilleriez ?
Marc Atallah : Il y en a tellement… Si on cherche à réfléchir aux dystopies du numérique, je ne peux que conseiller Neuromancien de Gibson, Transparence de Marc Dugain ou Les Furtifs de Damasio ; si c’est sur la consubstantialité entre utopie et dystopie que nous souhaitons nous pencher, j’irai lire La Possibilité d’une île de Houellebecq, L’Œcumène d’or de John C. Wright ou Un bonheur insoutenable d’Ira Levin. Mais à peine ai-je dit cela que je vois de nombreux autres titres se profiler, tous aussi essentiels les uns que les autres ! Plus généralement, toutes les dystopies contiennent, en elles-mêmes, une critique de l’utopie qu’elles narrativisent ; donc il y a beaucoup de romans incontournables, tout dépend de l’utopie que l’on veut voir problématisée…


Actusf : Quel film ? (ou série) Pourquoi ?
Marc Atallah : Là aussi, c’est compliqué, car il y a de nombreux titres ! Évidemment, on pourrait se référer aux chefs-d’œuvre (en même temps, on ne prend pas de risque en procédant de la sorte !), mais j’aime bien regarder les productions qui font moins consensus : Avatar, par exemple, est un film terrifiant qui montre, symboliquement, que vivre en utopie pourrait advenir à condition de quitter son corps et d’intégrer un « jeu vidéo » (n’est-ce pas dans ce champ que l’on parle, aujourd’hui, d’avatars ?) ; ou alors Clones, qui montre à quel point nous haïssons nos corps… Ce que j’apprécie dans les dystopies science-fictionnelles, c’est leur capacité à réaliser nos utopies – du confort, du bien-être, de la sécurité, etc. – pour montrer à quel point ces utopies sont aliénantes, à quel point nous acceptons de devenir étrangers à nous-mêmes pour des rêves qui, la plupart du temps, ne sont même pas les nôtres mais ceux véhiculés par une société.
Actusf : À quand le prochain livret ? Avez-vous déjà une idée du thème ?
Marc Atallah : Le prochain livret sortira en même temps que la future exposition de la Maison d’Ailleurs, dont le vernissage est prévu le 14 novembre 2020. Vu que cette exposition se nommera « Je est un monstre », le lecteur aura deviné la thématique du livret. Mais je n’en dirai pas plus pour le moment, ce n’est pas drôle sinon !
Actusf : Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Marc Atallah : Sur mille choses, comme souvent. En quelques mots, l’équipe du musée prépare la prochaine exposition, l’édition 2020 du Numerik Games Festival, plusieurs projets hors murs en 2020 et 2021, en particulier une grosse exposition à Montpellier. Quant à moi, plus personnellement, je suis en train de préparer plusieurs nouveaux cours – j’enseigne la littérature à l’Université de Lausanne – et d’écrire un livre scientifique sur les dystopies au cinéma. Il y a de quoi faire !