Franck Selsis est directeur de recherches au CNRS/Laboratoire d'astrophysique de l'Université de Bordeaux. Spécialiste des exoplanètes et de leurs climats, c'est aussi un connaisseur érudit de la science-fiction cinématographique. Il participe régulièrement aux débats CinémaScience du CNRS et propose dans cet article son point de vue personnel de scientifique sur Interstellar de Christopher Nolan. Ce type de film, qui utilise des concepts scientifiques, interroge sur l'équilibre entre factionnalité et fictionnalité.
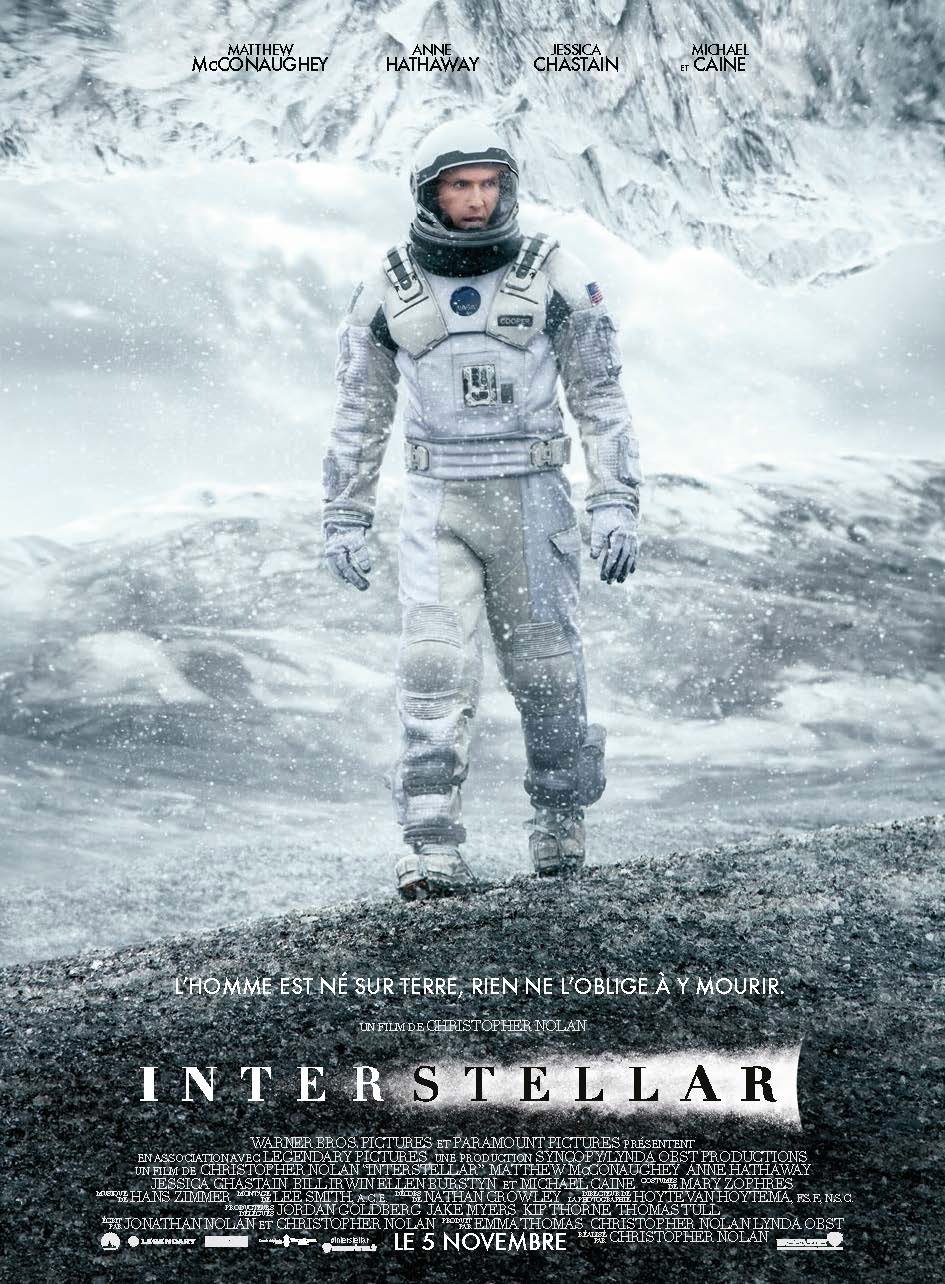
Avec une note de 8.6 sur IMDB, le film Interstellar de Christopher Nolan est à la 30e place des films les mieux notés, largement devant 2001, l’Odyssée de l’espace (90e place). Il a rapporté un demi milliard de dollars de plus que son coût de production. Ce film est aimé du plus grand nombre mais abhorré par une minorité sectaire qui n’y est pas juste indifférente. Elle s’en moque régulièrement, en citant des répliques hors contexte ou en détournant les pleurs co(s)miques de Matthew McConaughey, comme on se gausse de nanars de luxe tels que Top Gun, Armageddon ou 2012. On est comme ça, on est un peu bête. Je dis “On” car oui, je l’avoue, je fais partie de cette secte. Mais aujourd’hui je vais essayer de prendre un peu de recul, de revenir sur ce film sans moquerie et de tenter de comprendre un peu cette gentille haine, née d’une immense déception, elle même née d’un fantasme de cinéphile et d’amoureux de la science fiction.
Il y a quelques jours, j’ai été interrogé par Lloyd Chéry pour son excellent podcast C’est plus que de la SF au sujet de la crédibilité scientifique de ce film. Ce fut une expérience hautement sympathique mais aussi très frustrante. Frustrante car je suis interrogé en tant qu’astrophysicien alors que mon amour pour le cinéma est aussi fort que celui que je porte aux astres. Et dans le cas quasi unique et précis de ce film, je ne peux dissocier science et cinéma. J’aime Gravity alors que le film n’est absolument pas réaliste mais le cas d’Interstellar est plus compliqué et j’aimerais vous en parler un peu plus. Ce qui me pose un autre problème : on parle généralement mal de ce que l’on n’aime pas. Il serait un peu vain d’expliquer à celles et ceux qui vibrent devant ce film qu’ils ne vibrent en fait pas ou pour de mauvaises raisons, n’est ce pas ? Je vais donc essayer de vous parler d’un Interstellar que j’aime autant que d’un Interstellar que je n’aime pas. Ça ne changera rien sans doute à votre opinion et c’est tant mieux (c’est précieux un film qu’on aime !) et je dois admettre que j’écris certainement ici une petite histoire toute personnelle me permettant de faire une fois pour toute le deuil de ce film.
Nous sommes en 2014. Je me vois invité avec un collègue et ami astrophysicien, Sean Raymond, à une avant-première du film Interstellar de Christopher Nolan. Le film arrive précédé d’une promotion axée sur une ambition et un réalisme inégalés depuis 2001 l’Odyssée de l’espace, allant jusqu’à annoncer que les astrophysiciens ont progressé dans leurs connaissances des trous noirs en travaillant sur le film ! Voilà qui se prête parfaitement à une des séances Cinémascience du CNRS durant laquelle des scientifiques discutent échangent avec les spectateurs autour du film et de leur recherche.

J’accepte avec enthousiasme car j’attends Interstellar depuis longtemps. Et pas qu’un peu. C’est sans doute le film que j’ai le plus attendu dans ma vie avec La Dernière croisade et La Menace fantôme. En 2014, la SF au cinéma se cherche. Au cours de l’année écoulée on a vu de grosses productions Hollywoodiennes plutôt très moyennes comme Oblivion et Elysium, d’autres plus sympathiques mais qui sont — et c’est déjà beaucoup — de purs divertissements régressifs comme Edge of Tomorrow et Pacific Rim. Quelques grandes réussites comme Under the Skin de Jonathan Glazer ou Upstream Colors de Shane Carruth mais qui ne sont pas tournées vers les astres et leurs mystères. On a aussi vu avec le Gravity de Cuarón un beau film catastrophe dans l’espace mais rien qui vise ni le futur ni plus loin que nos actuelles stations orbitales. Aucune invitation sérieuse à visiter de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d’autres civilisations et, au mépris du danger, avancer vers l’inconnu.
Mais il y a ce film, en projet depuis des années et au confluent de mes deux passions, le cinéma et l’astrophysique : Interstellar.
Interstellar a cela de particulier qu’il est le projet d’un physicien, Kip Thorne. C’est l’un des très grands experts de la théorie de la gravitation d’Einstein (la Relativité Générale). Une légende vivante. Il obtiendra le Nobel de physique en 2017 pour sa contribution à la détection des ondes gravitationnelles, une des plus grandes prouesses scientifiques jamais accomplies. C’est aussi, comme beaucoup d’astrophysiciens, quelqu’un qui a exploré l’Univers via la science fiction avant de pouvoir le faire par les outils de l’astrophysique. Il cite en particulier l’incontournable trio Asimov, Heinlein, Clarke comme sources d’inspiration pour leur capacité à transformer la contrainte des lois de la physique en une source d’histoires extraordinaires. Ce que j’appelle le vertige du possible. Avant Interstellar, il a été sollicité par un autre astrophysicien célèbre et féru de SF, Carl Sagan, pour son livre Contact (que je vous recommande, disponible chez Mnémos) dans lequel Eleanor Arroway voyageait dans un trou de ver. Comme dans Interstellar.

L’astrophysicien Carl Sagan est l’auteur du roman Contact (1985, Simon & Schuster) , également adapté au cinéma par la Warner (Robert Zemeckis, 1997). Kip Thorne a contribué au livre avec l’idée du trou de ver qu’emprunte Eleanor Arroway (Jodie Foster dans le film). Matthew McConaughey (Cooper dans Interstellar) joue Palmer Ross dans Contact, un prêtre dont la foi fait contrepoids à la méthode scientifique de Arroway. Avant le grand voyage vers l’inconnu, Palmer offre à Ellie une boussole tandis que Cooper donne une montre à sa fille Murphy.
Thorne songe depuis longtemps à une histoire de SF pour le cinéma qui mettrait en scène des trous noirs. Ces objets astrophysiques d’abord prédits par la théorie et dont l’existence a ensuite été démontrée par leurs effets sur leur environnement (orbites d’étoiles, lentilles gravitationnelles, disques d’accrétion…). S’ils sont récurrents dans la littérature de SF, ils sont rarement exploités au cinéma sinon pour en faire des ogres aspirant la matière environnante, ce que bien sûr ils ne font pas. Les trous noirs fascinent par leur façon de maltraiter l’espace-temps, par leurs propriétés à la limite de nos capacités de conception. Comme celle de séparer l’Univers en deux zones strictement découplées par un horizon des évènements (event horizon) que l’on ne peut franchir que dans un sens et sans témoin, nous y reviendrons à la fin. La science fiction a souvent mis en scène le jeu des jumeaux de Langevin. L’un part pour un voyage à vitesse relativiste (c’est-à-dire proche de celle de la lumière) tandis que l’autre reste sur Terre. À son retour, comme les abductés de Rencontres du 3e type, il n’a guère vieilli alors qu’il a pu se passer un temps arbitrairement long sur Terre. Son jumeau est devenu un vieillard ou bien c’est son arrière arrière … arrière petit fils qu’il retrouve. Ce tour de magie de la relativité restreinte est une réalité parfaitement mise en évidence. Le trou noir, enfant prodige de la relativité générale, permet des jeux similaires avec le temps car celui-ci s’écoule d’autant plus lentement que la montre (ou l’organisme vivant) qui le mesure et le ressent est soumis à un champ de pesanteur élevé. Si deux jumeaux sont séparés à la naissance et que l’un passe sa vie sur la Lune tandis que l’autre reste sur Terre, ils n’auront pas le même âge biologique s’ils se retrouvent après que le couple Terre-Lune aura effectué mettons 30 révolutions autour du Soleil. Le jumeau lunaire sera plus vieux d’une fraction de seconde. C’est pas bézef. Pour le sense of wonder on reviendra. Non, pour que l’effet soit spectaculaire il faut une gravité monstrueuse ; il faut la matière la plus dense possible et s’en approcher. Près, très près. Une étoile à neutrons, ou mieux, un trou noir. Mais pas n’importe quel trou noir. Avec un trou noir issu de la mort d’une étoile massive et qui fera quelques masses solaires, le champ de gravité atteint certes des valeurs suffisantes aux abords de son horizon pour “ralentir le temps” mais le gradient de cette pesanteur est alors si prodigieux qu’il en est fatal. Sur un mètre de distance la pesanteur varie en effet de milliers de fois l’équivalent de la gravité terrestre, écartelant toute structure plus grande que le millimètre. Pour que ces “forces de marée” soient supportables par un vaisseau et des humains, il faut un trou noir supermassif comme on en trouve au centre des galaxies, comme celui de M87 qui a été imagé en 2019 et dont la masse est estimée à quelques milliards de masses solaires !

Ouvrages signés ou co-signés par Kip Thorne. De gauche à droite : une des bibles de la physique fondamentale, le Gravitation de Misner, Thorne & Wheeler (1973 pour la 1ère édition chez W. H Freeman, 2017 pour la dernière édition chez Princeton Univ. Press), Trous noirs et distorsions du temps : L’héritage sulfureux d’Einstein (1994, W. W. Norton & Company, disponible en français chez Flammarion) et The science of Interstellar (2014, W. W. Norton & Company).
Revenons sur Terre, à CalTech, L.A : Thorne pense aux effets dramatiques qui peuvent se produire aux environs d’un tel géant, d’un tel Gargantua. Sur une orbite proche de son horizon, le temps s’écoulerait plus lentement que pour ceux qui ne s’en approchent pas. Certes il faut atteindre des vitesses relativistes pour s’insérer sur une telle orbite et en repartir mais Thorne y réfléchit, trouve des solutions élégantes. Le physicien veut également déployer dans son récit les possibilités offertes par un trou de ver, cette solution théorique aux équations d’Einstein qui permettrait de créer un tunnel dans le tissu spatio-temporel entre deux points arbitrairement distants de l’Univers. On entre par un trou noir, on sort par un trou blanc, son symétrique qui peut se mettre en équation. Pure spéculation que ce trou de ver mais spéculation qui explore des zones encore mal comprises de la physique. Les trou de vers, existent-ils, peuvent-ils exister ? S’ils existent, la matière qui la traverse garde-elle une quelconque mémoire de sa complexité d’avant sa traversée. Dans ces zones floues de nos connaissances, Thorne s’autorise la spéculation et va exploiter un point qui est généralement avancé comme démonstration de l’inexistence des trous de ver : la possibilité qu’ils offrent d’un voyage dans le passé. De ces jeux spatio-temporels qu’il sait manipuler en tant que physicien, et qui titillent son imaginaire, Thorne va constituer petit à petit une histoire, une histoire de voyage interstellaire, de temps découplés, de voyages vers le futur, d’un message vers le passé.
Voilà pour la promesse astrophysique. Elle est immense. Mais à quelle sauce hollywoodienne allait-elle être cuisinée ? La SF d’astrophysicien intéressera-t-elle un producteur ?

Kip Thorne. Photo de Ricardo DeAratanha — Los Angeles Times/Getty Images
Nous sommes dans les années 2000s. CalTech n’est qu’à 30 min en voiture des studios, et Thorne se lit d’amitié avec une productrice d’Hollywood, Lynda Obst (à l’origine une blind-date arrangée par l’ami Carl Sagan) et, avec elle, ils font de ses histoires une ébauche de scénario. Et c’est alors que le projet va devenir, immédiatement, un mythe. Steven Spielberg est non seulement emballé par l’histoire mais il accepte, enthousiaste, de faire le film en respectant la double règle du jeu qu’impose Thorne :
1.Rien ne violera les lois de la physique et les connaissances de l’univers qui sont solidement établies.
2. Les spéculations sur des lois physiques mal comprises et sur l’univers viendront de la science fondamentale rigoureuse, d’idées qu’au moins certains scientifiques “reconnus” considèrent comme plausibles. (ça c’est la clause trou de ver !)

Steven Spielberg, photographié par Platon pour Wired.
Je dois, au moins partiellement, à Steven Spielberg mon amour du cinéma et ma vocation d’astrophysicien. Les Dents de la mer, Les Aventuriers de l’arche perdue et surtout Rencontres du 3e type m’éblouissent à jamais. Avec 2001, Odyssée de l’espace, ces Rencontres vont sceller un pacte entre les étoiles et moi. Objectif sur ces films, je ne pourrai jamais l’être. Ils font partie de moi et je ne peux les regarder avec recul. Ils sont. Point.
Et c’est donc Spielberg qui va mettre en scène les voyages spatio-temporels de Thorne. Après le duo Kubrick-Clarke, la SF cinématographique va être servie par le duo Spielberg-Thorne ! Pincez-moi ! D’immense, la promesse devient grandiose. Si Spielberg n’est pas sans défauts, il avance sans faux pas sur le territoire de la SF. Rencontres… (1977) , E.T. (1981), Jurassic Park (1993), puis sa “trilogie” constituée de A.I. (2001, dont il hérite de Kubrick), Minority Report (2002) et La Guerre des Mondes (2005). Avec dans chacun de ces films, un grand attachement au réalisme qui contribue à leur réussite. Le réalisateur est un curieux invétéré, il veut s’instruire sur les sujets qu’il traite et pour cela il aime s’entourer d’experts. Cela vient peut-être de sa relation avec Kubrick qu’il tient pour un maître totalement inatteignable. Pour adapter Crichton il s’entoure de paléontologues, pour A.I. il fait appel à des experts en intelligence artificielle et pour adapter Dick il organise un colloque scientifique pour imaginer le monde en 2054. Spielberg a aussi un profond respect pour les œuvres qu’il adapte, cherchant constamment le meilleur moyen pour raconter l’histoire, sans modifier artificiellement une histoire pour y insérer une virtuosité cinématographique qui s’auto-contemplerait. À l’exception de Ready Player One que l’on peut voir comme un film sur le cinéma de Spielberg et qui détourne le livre de Cline, Spielberg a le talent de s’effacer, d’adapter sa mise en scène à une histoire. Mais bref, restons en là, arrêtons de fantasmer sur ce que le projet aurait pu être car la SF de Spielberg (à moins d’un futur projet) restera à jamais à la surface de notre Terre mère. Les E.Ts et Martiens sont bien venus à sa rencontre mais pas de voyage interstellaire pour tonton Steven.
Après avoir donné vie au projet et avant de le quitter suite à la vente de Dreamworks, Spielberg engage Jonathan Nolan pour le scénario, ayant sans doute apprécié son travail sur Le Prestige. Mais le frérot de Christopher va s’avérer incapable de respecter la règle du jeu de Thorne ni d’apprécier le vertige que cette SF-là peut produire. C’est pas sa came. Il écrit un premier scénario daté de 2008 que l’on dit intermédiaire entre le scenario tourné et l’histoire de Thorne et Obst :
Une terre mourante, un fermier qui trouve une sonde étrange, mais pas de fantômes dans la bibliothèque. Un trou de ver d’origine extraterrestre dans le système solaire ouvrant vers un monde glacé à l’atmosphère respirable. Un voyage à destination de ce monde nouveau qui s’avère déjà colonisé par une mission chinoise dont seuls les robots ont survécu. Monde également peuplé d’être fantomatiques maîtrisant la gravité, le tissu même de l’espace temps. Un trou noir supermassif et un saut dans le futur, pour rejoindre une station que les robots ont mis un millénaire à construire. Millénaire nécessaire également pour que renaisse la Terre. Grâce à l’envoi d’une sonde à rebrousse-temps, pour boucler la boucle.
Le scénario quitte les mains de Spielberg mais reste dans la famille Nolan. Le trio Thorne-Nolan ne va pas fonctionner comme le duo Clarke-Kubrick. Il est difficile de savoir comment Thorne a vécu l’évolution de son histoire. Il va continuer à œuvrer sur le film et en devient même producteur exécutif mais il semble se désintéresser du produit final pour se concentrer sur les bénéfices financiers et scientifiques qu’il peut en tirer. Il propose aux Nolan de réaliser les simulations de trou noir les plus détaillées et réalistes jamais produites. Celles-ci serviront à la fois la science et le film car les images générées en collaboration avec le studio d’effets spéciaux pourront être intégrées au film. Pour cela il a besoin d‘un accès couteux à des supercalculateurs et de recruter des scientifiques mercenaires (des post-doctorants !). Il obtient un budget acceptable dans une telle production mais qui dépasse largement ce dont la recherche théorique en astrophysique a l’habitude. Nolan aura ses images mais il perd le consultant scientifique qu’il aurait pu avoir à ses côtés. Il perd son Clarke. Ce n’est pas grave, les Nolan ne tiennent pas au réalisme et vont démonter une à une les merveilleuses inventions du physicien. De nombreuses bêtises que l’on trouve dans le film auraient pu être facilement évitées. Mais ce n’est plus un enjeu. On quitte la Terre en fusée géante — normal — mais on décolle d’autres planètes de même gravité à la façon de la DeLaurean à la fin de Retour vers le futur. Partant d’un projet qui voulait explorer la gravité dans ses méandres les plus sophistiqués, on finit par se prendre les pieds dans les aspects les plus terre-à-terre de cette pesanteur trahie.

Le Ranger, (en haut) une des navettes équipant le vaisseau Endurance dans Interstellar. Comme les Lander (en bas) il peut se poser sur des planètes de gravité terrestre mais s’avère aussi capable d’en redécoller pour retourner sur orbite ! Il peut même s’insérer sur l’orbite de la planète de Miller autour de Gargantua et s’en échapper malgré les vitesses relativistes que cela implique. Des facilités invraisemblables que Thorne évitait dans son histoire d’origine.
À la question “Interstellar est-il un film réaliste ?” il est très difficile de répondre. On peut pointer du doigt des erreurs basiques comme je viens de le faire mais pour ce qui est du contexte astrophysique, le film est souvent trop confus pour qu’on l’on puisse avoir un commentaire scientifique. On peut déduire certaines choses du film, comme le fait brillamment Roland Lehoucq dans ces conférences en déduisant par exemple la masse minimale du trou noir du fait que la planète de Miller n’est pas détruite par les forces de marées. Mais quand on fait ça, on va je pense au-delà des préoccupations des Nolan. Je pourrais en tant que planétologue commenter les propriétés du système planétaire mais il n’est jamais décrit. On parle de planètes habitables, on suppose donc qu’il y a une étoile mais on ne la voit ni n’en parle jamais. Une des planètes est en orbite autour d’un trou noir. Comment concilier cela avec le reste du système ? Toutes les planètes tournent-elles autour du trou noir, la lumière du disque d’accrétion autour du trou noir (qui permet de visualiser le trou noir) est-elle la source de lumière qui donne sa chaleur aux planètes (ce qui les exposerait à des doses massives de rayonnement UV et X). Comment fait-on tenir tout ça ensemble ? On s’en fout et on le comprend dans une scène décisive. Quand l’expédition qui a franchi le trou de ver arrive dans le système en question, les membres d’équipage doivent décider de la planète à explorer. Ils auraient pu et du le faire avant (ils n’ont rien eu d’autre à faire pendant des mois) mais non, ils le font au dernier moment. Pour orienter les autres dans leur choix , le Dr. Brand, la scientifique du groupe, leur propose des informations, des données sur les planètes (sans doute leur environnement, leur atmosphère, leur température, leur gravité,..). Car oui cela peut-être important, non ? Non, cette proposition est écartée comme peu pertinente. On pourrait ainsi énumérer les invraisemblances mais ce serait vain puisque ce n’est pas un enjeu du film de Nolan.
La promesse astrophysique est rompue mais il nous reste le cinéma. Christopher Nolan a un sens de l’image et les mains libres. Certes on sortait de son Inception en ce disant “tout ça pour une fusillade en motos des neiges” mais on en gardait de belles séquences. Abandonnons donc Thorne et une part de nos rêves cosmiques et suivons les Nolan. Car nous voulons aimer ce film. Nous devons aimer ce film. Tout n’est pas perdu. C’est ce que je me disais dans mon fauteuil de cinéma, à mi projection de cette avant-première, tout n’est pas perdu. Je tentais de me convaincre que tout allait bien se passer, comme dans cette salle de San Francisco où je vis La Menace fantôme en 1999 et où repose une part de mes rêves.
Hélas cet Interstellar là n’est pas pour moi. Ce cinéma là n’est pas pour moi.
Quand Cooper fait le choix de quitter pour toujours sa ferme, sa planète et sa fille, il prend le volant de sa jeep et file vers cette NASA increvable qui, dénuée de moyens et au fond d’une base quasi abandonnée, a conçu et construit une mission spatiale d’une envergure totalement inédite. Là se présente une très belle idée de cinéma. Sa fille a l’habitude de se cacher du côté passager de la voiture. Il jette un œil au cas où elle lui aurait encore joué ce tour, ce qui lui aurait donné un ultime moment avec elle. Elle n’est pas là. Mais Nolan semble rarement capable dans ses films de laisser l’image seule véhiculer l’émotion, il lui faut soit du dialogue soit de la musique. Cooper étant seul ce sera donc le rôle de Zimmer de nous tirer une larme en poussant le volume sur 11. On dit que ce film déçoit les rationalistes qui ne s’intéressent qu’à sa véracité, qui n’ont pas de cœur et qui ne comprennent pas un film profondément humain. Bien que mal placé pour le faire, je refuse cette hypothèse. Mis en scène par nombre de réalisateurs plus spontanés, plus sobres, plus discrets, plus intimistes, ce moment m’aurait bouleversé. Par Nolan et Zimmer il m’a agressé, m’a dépossédé de toute l’émotion qu’il aurait pu m’offrir. L’astrophysique n’a rien à voir avec ça. Sur le plan du cinéma également, ce film m’est transparent.

Non, Murphy n’est pas cachée sous la couverture. Les images le disent, Hans Zimmer le martèle.
Si j’aimais le Nolan des débuts, et le suivais avec attention, il est devenu ce que d’aucuns appellent le cinéaste du Tout ça pour ça ?! Exemple. Une des idées phares du projet de Thorne est la différence entre le temps propre de ceux qui vont orbiter près de l’horizon du trou noir et celui des autres. Des jumeaux de Langevin gravitationnels. Une idée au formidable potentiel dramatique. Là où Thorne en proposait plusieurs variations progressant vers le vertigineux, qu’est ce que les Nolan en font ? Pendant les 3h passées sur la planète de Miller en orbite autour du trou noir, le pauvre astronaute resté dans le vaisseau mère a attendu 23 années. 23 années ! Un sacré sujet de film en soi ! Et… Et… rien. Les protagonistes se retrouvent, un peu gênés. T’as fait à bouffer ? Non, parce que bon on a la dalle, tu comprends on a fait du surf pendant 3h. NOON J’AI TOUT BOUFFÉ !!!! Bon j’avais dit que je me moquais pas. Je m’énerve tout seul. On efface.

Et nous arrivons à la fameuse boucle temporelle. Tentation ultime des histoires de SF. À Laquelle Villeneuve ne résiste pas à la fin de Arrival, abandonnant ainsi le merveilleux concept de Ted Chiang qu’il tenait pourtant à sa merci… (mais bon Arrival reste malgré quelques défauts dont cette dérive finale une belle et rare proposition). Chez Thorne, c’est la sonde qui ferme la boucle. Conçue par Cooper et les robots de millième génération, elle est renvoyée sur Terre et dans le passé. Une prouesse permise par le trou de ver creusé par les êtres évoluant dans une dimension orthogonale à notre espace temps. Mais pour Nolan c’est la conjonction entre le pouvoir du trou noir et celui de l’amour filial qui va envoyer dans le passé à sa fille Murphy le message spirite de Cooper. Murphy qui finira par retrouver son père, plus jeune qu’elle. Sauf que — pour faire un bref retour vers la science - Cooper n’a jamais atteint le trou de ver du point de vue de sa fille, il voguera à tout jamais vers son horizon… Mais reparlons-en à la fin.
Si la promotion du film a beaucoup misé sur le réalisme scientifique, c’est sans doute par un effet mémoire du projet initial mais c’était aussi pour jouer sur une filiation revendiquée avec 2001 l’Odyssée de l’Espace. Film que vénérait autant Thorne que Spielberg et C. Nolan (qui a dirigé la non restauration du film). De nombreuses références à 2001 constellent Interstellar, comme une invocation à une divinité incomprise, du robot TARS, hybridation de HAL et du monolithe, à la scène d’arrimage du Lander qui doit synchroniser sa rotation avec le vaisseau Endurance, tout comme la navette Orion de la Pan Am doit d’abord valser avec la grande roue orbitale pour pouvoir l’accoster dans le film de Kubrick. Parade avant l’accouplement cadencée par Johann Strauss dans un cas et et Hans Zimmer dans l’autre. Des sensualités différentes... Et malgré cet héritage revendiqué, je pense que l’on peut dire assez objectivement que 2001 et Interstellar sont deux films que tout oppose.
2001 est basé sur une histoire et un contexte extrêmement fouillés, imaginés par le duo Kubrick-Clarke. Dans ce matériel Kubrick va tailler comme un sculpteur ne gardant qu’une silhouette gracieuse d’un bloc monolithique, il ne va conserver qu’une trame minimaliste, succession de quelques séquences. Mais l’incroyable travail en amont est omniprésent : chaque personnage a une histoire, la situation géopolitique est connue, chaque vaisseau a ses caractéristiques détaillées et réalistes. Jusqu’au bout du montage Kubrick a coupé, notamment des dialogues. Clarke en fut profondément affecté, à plusieurs étapes de la conception de 2001 et jusqu’à la première du film, découvrant que des pans entiers de sa contribution avaient été supprimés. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’il admettra que oui, Kubrick avait raison. Car si ses moments et dialogues supprimés en laissent d’autres orphelins, le spectateur peut reconstituer le tout. Son tout. Car chacun quitte le film avec son propre 2001.
Une de ces ellipses est effarante. Dans ce qui est l’un des plans les plus connus du cinéma, un satellite en orbite autour de la Terre vient remplacer un os lancé par un pré-humain. Or, la maquette de ce satellite a été conçue comme celle d’une plateforme lance-missile pointée vers la Terre (comme dans le film Meteor pour qui s’en souvient). Cela passe inaperçu et pourtant non seulement cela contient des indications sur la tension géopolitique mais cela fait de ce plan une transition entre deux armes dont le progrès n’a fait qu’accroitre la létalité, donnant à ce cut un sens prodigieux, une des clés du film. Mais cela n’est jamais explicité. Le spectateur ne sait pas a priori que ce satellite pointe des missiles nucléaires vers la Terre. Quelle audace de la part de Kubrick ! Un peu comme s’il construisait une maquette de navire ultra détaillée mais dont les détails seraient masqués, invisibles une fois la coque refermée. Des détails subliminaux à l’influence infinitésimale mais collectivement indéniable. Quelle folie peut-être aussi. Folie, génie, qui pourrait expliquer que ce film n’a pas de filiation.

Si personne n’a vu le même 2001 nous avons tous vu le même Interstellar, qu’on l’aime ou non, car ce film ne propose ni ces espaces réceptacles de nos imaginaires, ni cet univers de détails à la lisière de la perception. Tout ce qui est important est montré, expliqué de façon frontale. Ce qui est éludé, comme l’architecture des mondes que nous visitons, fait confusion et non cohésion.
Et loin d’être une épure allégée à l’extrême, Interstellar accumule des péripéties se greffant sur un projet à la base beaucoup plus resserré : plus de planètes, plus de Matt Damon, plus de relations père-fille, plus de Zimmer. Et plus de dialogues. Bizarrement pour un film qui ne vise pas le vertige du plausible mais uniquement son apparence, le film est assez bavard, explicatif sans avoir d’explication. Curieux pour un film tout en effets qui converge vers un tour de magie. De vraie magie. Pas celle de Clarke.
Je ne sais comment Thorne a vécu la dilution de ses idées dans un récit qui n’a plus de support physique ou logique bien identifiable. Interrogé par ses collègues à ce sujet, il répond qu’il s’est mis au service des réalisateurs en intervenant quand ils avaient besoin de lui. Ils souhaitent une planète où le temps s’écoule 60000 fois moins vite. Il leur répond qu’une telle planète n’est pas atteignable par le vaisseau des explorateurs. Fais de ton mieux, c’est le principe qui compte, demandent les Nolan. Il fait au mieux. Et au fond il a bien raison. Son film rêvé, contrairement à nous, il le porte en lui, et il a su tirer parti du projet qui a financé sa recherche au-delà de ce qu’il aurait pu espérer de la NASA ou de la NSF ; il a personnellement touché le jackpot sur les recettes du film ; il pu savourer à l’écran son Gargantua, sa création, dont la présence dans le film est une réussite indéniable (même si le disque d’accrétion que l’on voit devrait empêcher toute approche du trou noir) et il a pu expliciter sa science et son projet dans son livre The science of Interstellar ; il a fait un caméo dans The Big Bang Theory. Oh, et il a obtenu le prix Nobel de Physique.
On ne peut nier qu’Interstellar est un film d’auteurs. D’auteurs qui ont glané ça et là dans le concept de Thorne ce qui les inspiraient. De quoi nourrir les obsessions de Nolan sur le temps. Sur les temps. D’auteurs qui ont su trouver un public. Il n’est pas rare de rencontrer quelqu’un que le film a profondément marqué. Et honnêtement, s’il m’avait laissé indifférent comme la majorité des films que je vois et que j’oublie instantanément, je n’en parlerais pas aujourd’hui. Peut-être devrais-je le revoir, histoire de le prendre juste pour ce qu’il est et non plus pour ce qu’il aurait pu être. Mais je crois qu’au mieux le revoir adoucira ma déception. Tant mieux si le film plait, s’il pu relancer des projets de SF ambitieux, tant mieux s’il ouvre à la SF, à l’espace, à la science et au cinéma. Peut-être qu’il sera le Rencontres du 3e type d’un enfant. Je le souhaite. Mais je ne pense pas le revoir car je préfère imaginer un autre Interstellar. Celui de Thorne et de mon tonton Spielberg qui, le temps d’une promesse, fut un grand film que je range au côté du Napoléon de Kubrick et du Dune de Jodorowsky et Moebius. Il existe le Dune de Lynch, il existe aussi le Interstellar des Nolan. Soit !

Première image synthétique d’un trou noir entouré d’un disque d’accrétion, réalisée par l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet en 1979 et Gargantua, le trou noir supermassif dans Interstellar.
Quittons-nous sur un vertige. Un de ces vertiges du possible. Un trou noir ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Gargantua, le trou noir supermassif d’Interstellar, évoque le géant de Rabelais qui absorbait tout et en quantités impressionnantes, connaissances comme nourriture. Et pourtant, rien n’est jamais tombé dans un trou noir et rien n’y tombera jamais. Pas de notre point de vue en tous cas, car atteindre son horizon prend un temps infini. Le seul moyen de voir quelque chose tomber dans un trou noir est d’y tomber soi même. Si un jour un trou de ver apparaissait dans le système solaire et que nous y envoyions quelques courageux volontaires, nous ne serions jamais témoins de leur traversée, nos instruments pointés vers le trou noir nous enverraient leur image rougie, se figeant pour l’éternité aux abords de l’horizon des évènements. J’ai réalisé ça quand j’étais au lycée en lisant le merveilleux livre de Jean-Pierre Luminet, Les Trous noirs. Je vous en conseille infiniment les vertiges.
Franck Selsis, Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, CNRS- Université de Bordeaux, franck.selsis@u-bordeaux.fr
Crédits pour les images de film : Contact et de 2001 l’Odyssée de l’espace © Warner Bros. Picture, Interstellar © Syncopy / Lynda Obst Productions / Warner Bros et Rencontres du 3ème type © Sony Pictures








