Le monde existe : la preuve, il possède une chronologie.
Ce n’est pas une remarque anodine. « Anamnèse de Lady Star » s’ouvre sur cette chronologie, garantissant que tout ce qui raconté — vrai ou faux, correctement ou incorrectement interprété — court sur une durée de 62 ans, entre -18 et +54, le 0 correspondant à l’« Attentat d’Islamabad », déclencheur du « Satori », la « pandémie terrifiante », comme il est dit en quatrième de couverture. Ce n’est pas un remarque anodine, car il serait alors trop facile, et surtout bien dommage, de se débarrasser de l’ensemble des problèmes à la fois crispants, obsédants, horripilants et passionnants que soulève le roman — ou que l’on se fabrique soi-même par dessus le marché en cours de lecture —, en décrétant que tout ceci ne serait que l’immense hallucination d’un des personnages, ou une sorte de synthèse onirique des hallucinations de plusieurs personnages : des rêves et des hallucinations, ce n’est pas ce qui manque dans « Anamnèse de Lady Star », mais cette chronologie, exposée avant même la page de titre — je refuse de savoir que c’est un procédé de l’éditeur, qui pratique de manière similaire avec d’autres romans de statuts tout différents —, entérine l’existence formelle de l’univers de référence, avec ses principes, ses invariants, sa charte implicite, sur lesquels se projette le drame. Exit l’échappatoire facile, si l’on veut chroniquer « Anamnèse de Lady Star », il faut loyalement accepter le risque de s’y casser les dents.
Pour cette raison, je ne vais pas chroniquer « Anamnèse de Lady Star » de manière conventionnelle. Pour le faire, il aurait fallu que je me livre à une seconde, voire une troisième lecture. Je me suis contenté d’une lecture, disons, d’une lecture et demie, car il fallait bien vérifier des détails, reprendre quelques notes et choisir des citations un peu parlantes. Le texte qui va suivre ne constitue donc qu’un simple survol de ce roman-monde, où je me contenterai — ce n’est d’ailleurs pas si facile, je m’en aperçois en cours de rédaction — de porter le regard sur tel ou tel aspect, en utilisant une loupe, parfois un microscope et, de temps à autre, un scalpel. Le terme de « survol » paraît même trop fort : plutôt des coups de sondes, pratiqués un peu aléatoirement, comme s’il s’agissait de remonter des échantillons du fond d’un océan par ailleurs trop vaste pour être réellement appréhendé globalement.
Cette petite série de réflexions et digressions informelles, si jamais elle est goûtée, le sera peut-être davantage par un lecteur qui aurait déjà lu le roman, que par celui qui se demande s’il va le lire. À ce dernier qui s’interroge, qu’il cesse d’hésiter sur l’instant, c’est en tout cas mon conseil : « Anamnèse de Lady Star », est un monument, qu’il est hors de question d’ignorer si l’on se passionne pour la science-fiction.

Résumons tout de même une partie de ce qui ne peut être mis en doute, que le lecteur doit accepter comme indiscutable, la trame grossière du récit. Dans un futur qui semble proche, une bombe d’une nature particulière a explosé à Islamabad, marquant le départ d’une pandémie terrifiante, donc, qui provoque l’anéantissement d’une grande partie de l’humanité. L’arme a été mise au point à partir des théories et découvertes d’un scientifique, le professeur Stéphane Aberlour. Autour de ce savant s’est créé une groupe au fonctionnement sectaire qui a favorisé la mise au point de l’engin et fait en sorte qu’il soit effectivement utilisé. Les membres du groupe ont été systématiquement traqués et les survivants jugés dans un procès, dit de la commission de Kanazawa, sous la direction professeur Jiro Izu. Tous, sans exception, sont censés avoir trouvé la mort, soit dans le terrifiant chaos qui a suivi le « Satori », soit exécutés à la suite du procès. Des zones d’ombres subsistent cependant et un organisme du nom de « Vergiss mein nicht » est chargé d’enquêter inlassablement afin de déterminer si des responsables ignorés auraient échappé aux mailles du filet, avec comme consigne de les éliminer en cas de découverte : il faut de toute force « refermer la boîte de Pandore ». Sous la houlette de son maître, l’universitaire Christian Jaeger, une étudiante, Magda Makropoulos, fouille le passé et recontacte d’anciens témoins : en passant les archives informatiques au peigne fin, la chercheuse pense avoir repéré un personnage demeuré jusqu’alors totalement inaperçu, une femme, qui aurait un moment porté le nom d’« Hypasie » et aurait appartenu au groupe d’Aberlour. Hypasie aurait joué un rôle important, peut-être central, dans le déroulement de cette tragédie planétaire. Encore faut-il déjà prouver son existence, pour ensuite, si c’est le cas, la retrouver et l’exécuter… « Anamnèse de Lady Star » retrace minutieusement cette enquête, jusqu’à sa conclusion.
Pour raconter cette traque — et quelle traque ! —, L.L. Kloetzer a, en très gros, découpé le chapitrage du roman en autant de rencontre avec les témoins clés. Dans chaque nouveau chapitre, on retrouve pratiquement à chaque fois et fort à propos une petite citation du chapitre précédent, ce qui fait que la transition s’effectue d’une manière parfaitement logique et cohérente : aucune volonté de perdre le lecteur, tout au contraire, il se trouve guidé, presque pris par la main. Et il en a bien besoin ! En effet, si la continuité d’« Anamnèse de Lady Star » ne doit pas poser de problème au lecteur un peu attentif, il en va tout autrement quand il s’agir d’absorber, ou plutôt de digérer et mettre en perspective la quantité phénoménale d’informations qui se trouve distillées à tout moment, et de toutes les manières possibles.
Je dois confesser ici que les romans où le lecteur se trouve écrasé par des tombereaux de renseignements qu’il faut sans cesse engranger et classer dans sa mémoire, ont assez généralement tendance à me fatiguer et me tombent rapidement des mains. Mais j’ai écrit : « assez généralement »… et avec « Anamnèse de Lady Star », c’est la délicieuse exception qui s’est produite, comme trop peu souvent. Ce n’est pas l’ennui qui s’est installé, c’est l’exact contraire : la fascination. Oserais-je dire que j’ai retrouvé en lisant le roman de L.L. Kloetzer quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j’ai éprouvé, il y a bien longtemps, en lisant « Dune » de Frank Herbert ? J’ai été hypnotisé.
Mais sortons momentanément de cet état et lançons quelques sondes. Pourquoi ne pas s’intéresser, pour commencer, à l’origine même d’Hypasie ?
L’énigme des Elohims
Dès le premier témoignage, celui de Callixte Longtun, Hypasie, qui s’appelle encore Kirsten Lie, est présentée comme une « Elohim » :
« Callixte n’a jamais cru au Contact, comme tout catholique éduqué il est très soupçonneux dès qu’il entend parler d’un miracle. […] Il avait une vingtaine d’années quand tout a commencé, il pensait que la mode extraterrestre serait vite passée ; sur ce point, il admet s’être trompé.
Dans les discussions il faisait partie des sceptiques, des méfiants. Le phénomène a enflé, il y a eu l’Agora, les résurgences, les témoignages de plus en plus nombreux de la présence des autres, ceux qui ne sont pas nés d’une femme. Un sociologue quelconque l’a constaté : nous sommes maintenant tous à moins de trois degrés de séparation de l’un d’entre eux. Mais, même mis en présence d’un fils des étoiles, la plupart des gens continuaient à croire à un complot américain/chinois/saoudien. Comment croire à des étrangers si semblables ? Qui nous connaissaient si bien ? Comment expliquer que si peu de choses ait changé depuis leur apparition, sinon par le fait évident que l’ensemble de cette histoire relevait d’une forme d’illusion collective ? L’Agora est devenu un lobby influent, […], on a parlé d’utilisation militaire des capacités métacognitives des fils des étoiles, quelques mythes du surhomme ont été réactivés. La fusion de la minorité Elo dans la société a surtout entraîné le développement des publicités invasives, des théories du Gestalt, des tenant de la déconnexion totale et des arcs narratifs de nombreux soap de qualité. Un peu de fiction se rependait dans le monde réel, comme toujours. Et les revendications sociales des Elo et de leurs amis sonnaient tout aussi creux que celles des clans gays et lesbiens, quelques décennies plus tôt.
On ne pouvait toutefois plus ignorer leur présence. […] Il essaie de comprendre quelque chose aux théories du swap, à l’imprégnation mimétique, à tous les phénomènes hypnotiques entourant les fils des étoiles. […] »
 « Imprégnation mimétique », « phénomènes hypnotiques », voilà qui colle bien à l’énigmatique Hypasie/Kristen Lie, styliste et maîtresse du professeur Abelour, mais la qualifier d’« Elohim », c’est expliquer une énigme par un mystère… Cependant, à ma première lecture, une expression m’a immédiatement frappé : « fils des étoiles », qui s’est instantanément transformée en « enfants des étoiles », comme chacun sait le titre d’un roman de H.G. Wells, publié en 1937 et traduit en français en 1939… Je me permets de me citer moi-même, en recopiant un extrait du petit guide « H.G. Wells, parcours d’une œuvre » (Encrage, 1998) qui résume le roman :
« Imprégnation mimétique », « phénomènes hypnotiques », voilà qui colle bien à l’énigmatique Hypasie/Kristen Lie, styliste et maîtresse du professeur Abelour, mais la qualifier d’« Elohim », c’est expliquer une énigme par un mystère… Cependant, à ma première lecture, une expression m’a immédiatement frappé : « fils des étoiles », qui s’est instantanément transformée en « enfants des étoiles », comme chacun sait le titre d’un roman de H.G. Wells, publié en 1937 et traduit en français en 1939… Je me permets de me citer moi-même, en recopiant un extrait du petit guide « H.G. Wells, parcours d’une œuvre » (Encrage, 1998) qui résume le roman :« L’historien Joseph Davis est saisi d’une sourde inquiétude. Sa femme, enceinte, lui paraît avoir un comportement étrange. Et une puissance extraterrestre, des Martiens peut-être, tentait de modifier, de « martianiser » l’espèce humaine, en bombardant les chromosomes humains au moyen de rayons cosmiques ? Ce serait la plus subtile des invasions. Certains indices laissent à penser que cette idée n’est pas si fille que l’on pourrait le croire, et la curieuse obsession de Davis contamine quelques penseurs qui l’interprèteront à leur manière.[…] Ce dernier scientific romance est surtout prétexte à philosopher sur l’avenir de l’humanité, mais l’idée de base reste fascinante. […] »
Une seconde référence m’est venue à l’esprit, mais moins rapidement, car je ne connais guère le dossier : celui des prétendus « enfants indigo », bizarre mouvement New Age initié dans les années 70-80 du XXe siècle et popularisé par le nombreux écrits d’un couple d’illuminés, Lee Carroll et Jan Tober : des enfants naîtraient de temps à autre avec des caractéristiques psychologiques — et parapsychologiques — particulières, qui les désigneraient comme une nouvelle étape de l’évolution de l’humanité. Lee Carroll et Jan Tober étant des adeptes convaincus du « channeling », prétendu procédé de communication télépathique avec des entités surnaturelles ou extraterrestres, tout se tient… H.G. Wells aurait sûrement été surpris de voir ainsi bizarrement déformée et factualisée une de ses idées ! L.L. Kloetzer, en créant les « Elohims », a réalisé une habile fusion des « Star Begotten » wellsiens et des « star children » du New Age. On y voit donc un peu plus clair, mais on ne saura pas, dans « Anamnèse de Lady Star » si la qualité d’« extraterrestre » d’Hypasie, comme des autres « Elohims », doit être prise au pied de la lettre. Au lecteur d’interpréter. Hypasie conservera en tout cas tout un long du récit un caractère que l’on pourrait qualifier de numineux. Sans excès, cependant : que les sensibilités matérialistes se rassurent.
Les étranges études du professeur Aberlour
Il est dit somme toute assez peu de choses sur la personnalité du professeur Stéphane Aberlour. Les renseignements sont plus précis, concernant ses recherches : le scientifique est à l’origine de la « théorie des déclencheurs et des assonances profondes ». Ces travaux intéressent le colonel Antonin-Patrice Darsonval, un spécialiste de la guerre psychologique qui dirige, pour l’armée française, le « programme Pytagore ». Un projet de manipulation de masse qui va tenter d’exploiter les idées d’Aberlour pour :
« […] transformer la culture d’un peuple de l’intérieur par une révision de ses fondamentaux psychoculturels. Un rêve de psychopathe : et si on commençait par réinitialiser tous les emmerdeurs en modifiant leurs idées sans même qu’ils s’en aperçoivent ? Calmons les énervés, apaisons les esclaves, et convainquons tous nos immigrés clandestins de se rendre dans les camps de refoulement. […] » (p.36)
D’après un informateur de Callixte Longtun, Aberlour, Darsonval et le groupe de comploteurs sectaires qui se forme autour d’eux, il y a péril en la demeure :
« Nous sommes dans un réduit assiégé, notre civilisation, nos racines sont attaquées à la base, retournons à nos fondamentaux (lesquels ? la triade prêtre/guerrier/paysan ?), purifions et coupons les branches malades de l’arbre en y injectant les dernières trouvailles de la guerre médiatique, influences subvocales, déformation du tissu informationnelle, intoxications mémétiques… » (p.36)
Hypasie, avec laquelle Callixte Longtun s’imagine avoir entamé un relation sado-masochiste dans laquelle il jouerait le rôle de dominateur — la complète subjugation sexuelle du sujet est un des moyens habituels de manipulation utilisés par Hypasie — lui en dira davantage, pour mieux le ferrer :
« Ils cherchent ensemble à utiliser les icônes comme des armes. Stéphane cherchait les signes faisant écho aux structures de la psyché. Il les a trouvés. Ils peuvent affecter l’état d’esprit, les émotions, les croyances fondamentales d’une personne. Il faut être confronté à une version suffisamment pure du signe. Stéphane les a trouvés, les a raffinés. Ils peuvent affecter ta confiance en toi, tes fidélités, ta colère, tes amours, tes haines. Su tu y es confronté ils créent un choc, ils modifient ce que tu penses, ce que tu es… […] Les dessins sont des traces. Les signes sont vivants. Stéphane exploitait la voie des ennéagrammes, les effets mandala, les illusions d’optique, pour tenter de les rendre présents. La calligraphie permet d’apprendre les gestes qui les convoquent. Darsonval les a appris, il a fondé un groupe pour les reproduire, mettre au point des machines, des systèmes médiatiques qui les multiplient. Ils ont testé la chose en Asie, dans des opérations de maintien de l’ordre, ils ont abattu psychiquement des villages entiers. » (p.62-63)
 Il m’a semblé retrouver, avec ce projet d’utiliser des « icônes comme des armes », l’écho d’un roman du Paul J. McAuley, « Mind’s Eye » (2006), traduit en France sous le titre « Glyphes » (2010). L’auteur britannique y développait de manière trop succincte l’idée selon laquelle la vision de certains types d’images — les glyphes en question —, associés à l’usage de drogues psychotropes, pouvait influer sur le cerveau et modifier le comportement. Dans le roman de Paul J. McAuley, les glyphes, d’origine ancienne, avaient été découverts au cours de fouilles archéologiques et utilisés, en grand secret, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la forme de tracts. L.L. Kloetzer développe le concept à sa manière et surtout invente la terrifiante « bombe iconique » qui provoquera le « Satori ».
Il m’a semblé retrouver, avec ce projet d’utiliser des « icônes comme des armes », l’écho d’un roman du Paul J. McAuley, « Mind’s Eye » (2006), traduit en France sous le titre « Glyphes » (2010). L’auteur britannique y développait de manière trop succincte l’idée selon laquelle la vision de certains types d’images — les glyphes en question —, associés à l’usage de drogues psychotropes, pouvait influer sur le cerveau et modifier le comportement. Dans le roman de Paul J. McAuley, les glyphes, d’origine ancienne, avaient été découverts au cours de fouilles archéologiques et utilisés, en grand secret, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la forme de tracts. L.L. Kloetzer développe le concept à sa manière et surtout invente la terrifiante « bombe iconique » qui provoquera le « Satori ».On en apprend davantage dans le chapitre « Hypasie. Islamababad, quelques jours après le Satori », sur lequel il est utile d’apporter quelques précisions. Ce chapitre, qui donne le compte-rendu de l’interrogatoire du militaire français Yvan Legorre, secrètement chargé de faire exploser la bombe iconique à Islamabad, est paru auparavant en tant que nouvelle sous le titre « Trois singes » dans l’anthologie de Serge Lehman « Retour sur l’horizon » (Denoël, 2009). Je dois avouer qu’à l’époque, je n’avais que moyennement adhéré à la nouvelle, la trouvant un peu trop confuse — au sens où j’avais l’impression que l’auteur, alors Laurent Kloetzer et non pas L.L. Kloezer, voulait exprimer beaucoup trop de choses sur une distance bien trop courte —, et sans un peu irrité par le ton du narrateur, le type du militaire brutal et bien lourd assez fatiguant : certes, c’était voulu, mais c’était un peu pénible. Une fois la nouvelle enchâssée dans « Anamnèse de Lady Star », mon point de vue s’est complètement inversé : l’ancienne nouvelle devient une précieuse pièce du puzzle, et Yvan Legorre n’est plus qu’un personnage parmi les autres. Il n’y a plus lourdeur, mais contraste avec les différents types de personnalités amenés plus ou moins volontairement à apporter leur témoignage. L’épisode du porteur de la bombe iconique s’intègre alors tout à fait harmonieusement dans le flot d’informations.
On notera déjà qu’Yvan Legorre confirme le caractère sectaire de l’entreprise :
« Je ne peux pas tout vous expliquer, je suis sûr que je n’ai pas vraiment compris, leur affaire était à la fois de la science et de la philosophie […]. Darsonval faisait partie du groupe de disciples depuis longtemps. Hypasie était l’oracle, la prophétesse de la secte […]. » (p.97)
Le militaire français insiste sur l’importance d’un facteur, nécessaire à la compréhension du fonctionnement et de l’utilisation de la bombe iconique, à savoir la « signature culturelle ». En quelque sorte, doivent être affectés par la bombe iconique — c’est-à-dire se retrouver à l’état de légume, le syndrome dit « TMS » (« Three Monkeys Syndrom »), ne plus rien voir (« les yeux blancs »), ne plus rien entendre, ne plus rien dire — exclusivement les individus appartenant à une certaine culture ! Le militaire cite des expérimentations menées au Kafiristan (une authentique région de l’Afganistan, et non un pays imaginaire, comme je l’ai, avec désinvolture, supposé un moment) :
« C’est une question de signature culturelle : les Kafirs sont fortement différenciés. Musulmans, à leur façon, tribaux, à leur façon, communistes, à leur façon. Je simplifie. Nos missions consistaient à relever les marqueurs culturels des morts et des vivants, suivant huit critères : langue, histoire, famille, empathie, religion, organisation sociale niveau 1 & 2, implication. Pour voir si la maladie faisait des différences, si elle frappait plutôt les Kafirs, les Ouzbeks, les Kirghizes, ou plutôt les Chinois, les Russes, les Européens, comme vous voulez… On faisait des relevés d’ADN culturel. » (p.94).
Hypasie elle-même — si elle existe … — a fourni à Ivan Legorre ses explications personnelles :
« […] Et de toutes ces combinaisons de signes, il en existe une qui porte en elle l’anéantissement de l’esprit humain. Un signe, une bête, des lettres vivantes qui s’inscrivent dans les replis du cerveau et provoquent son effondrement. Mon maître [le professeur Aberlour] a découvert cette combinaison, nous en sommes les gardiens. Ce signe abat l’esprit en quelques heures, il marque la personne touchée et se transmet d’humain à humain, dans les échanges de regard, dans les conversations, dans l’étreinte paniquée de la mère sur son enfant, dans la bénédiction du prêtre, dans le discours des policiers, des hommes politiques. Chaque transaction entre deux êtres humains passe le mot, propage l’icône, le signe. Je lui parle, il acquiesce, ne serait-ce que d’un signe de tête, et le signe passe, il mourra à son tour. Le signe passe par la voix, le téléphone, la vidéo, la télévision, on se croit protégé et pourtant, à chaque instant, la mort au fond des yeux vous salue. » (p.96-97)
Il s’agit donc, au moyen d’une pandémie « iconique », d’éradiquer les indésirables qui empoisonnent l’Occident. C’est toujours Ivan Legorre qui parle :
« Abattre d’un coup tous les Arabes, tous les musulmans, peut-être quelques indiens, quelques Noirs, quelques Chinois en même temps, on s’en fout. Épargner la vieille Europe et ceux des Américains qui ne sont pas trop dégénérés […]. » (p.97)
J’ai fait référence au roman de Paul J. McAuley comme inspiration possible de L.L. Kloetzer pour les théories d’Aberlour, mais il s’agit là d’un source fictionnelle. J’avoue qu’il ne me vient pas à l’esprit le nom de scientifiques ou pseudo-scientifiques qui auraient développé cette idée d’icônes, de glyphes, ou de signes agissant directement sur le psychisme. À la rigueur, on pourrait évoquer certaines théories concernant l’action subliminale des images, émises dans les années cinquante : la vision subliminale — en principe non consciente — d’une image favoriserait un comportement. Efficientes ou pas — à ma connaissance, l’efficacité du procédé n’a jamais été prouvée, en tout cas pas sa leur formulation canonique : une image subliminale positive ou négative entraînant une action correspondante du sujet exposé —, ces idées ont été reprises dans plusieurs thrillers ou films d’espionnage. On pourrait aussi évoquer les prétendues techniques dites de « lavage de cerveau » ou de conditionnement, dont certaines font appel aux drogues, elles aussi mises largement en application dans la fiction, même si dans la réalité, la documentation à ce sujet s’avère beaucoup moins convaincante. Ces idées demeurent dans l’air, mais l’on reste très loin de ce que semblent suggérer les théories d’Aberlour. J’ai l’impression qu’il faudrait chercher plutôt du côté d’une certaine branche de la psychanalyse pour trouver quelque chose qui ressemblerait à des glyphes, à des icones, à des signes, capables, comme l’affirme Hypasie, « de porter à incandescences l’impact psychique des émotion ». Ou plutôt, le phénomène inverse — qu’il faudrait alors supposer réversible pour le bombe iconique d’Aberlour ait une chance de fonctionner —, c’est-à-dire la production d’icones symboliques par le sujet, icones qui incarneraient alors
 des éléments de sa personnalité profonde. Je pense évidemment aux théories du célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875-1961) sur les archétypes, vues comme des sortes de structures mentales innées. Hypasie parle d’ailleurs d’« effets mandala », et on sait que Jung s’est beaucoup intéressé aux « mandala », terme qui signifie « cercle » en sanscrit. Par exemple, Jung, dans son essai « Un mythe moderne » (« Ein Moderner Mythus », 1958), voulait voir dans la forme des soucoupes volantes celle d’un mandala, interprétant l’ensemble du phénomène comme l’expression d’une angoisse psychique collective. Les mandalas et autres ennéagrammes — terme dont l’invention est attribuée à Gurdjieff (1877-1949), soit dit en passant — découverts par le professeur Aberlour fonctionnerait dans le sens inverse de celui décrit pas le psychiatre suisse : au lieu de constituer des émanations de l’esprit humain ou de l’inconscient collectif cherchant à s’extérioriser, les signes en question, produits artificiellement, agiraient sur l’esprit du sujet lorsqu’ils sont observés par ce dernier. Un aspect qui rapprocherait Jung d’Aberlour est cette idée que les « races » pourraient posséder des psychés différentes. Dans une « Introduction » au recueil d’essais « Jung and the Shadow of Anti-Semitism » (Nicholas-Hayes, 2002), édité par Arieh Maidenbaum, le Dr. Stephen A. Martin rappelle que :
des éléments de sa personnalité profonde. Je pense évidemment aux théories du célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875-1961) sur les archétypes, vues comme des sortes de structures mentales innées. Hypasie parle d’ailleurs d’« effets mandala », et on sait que Jung s’est beaucoup intéressé aux « mandala », terme qui signifie « cercle » en sanscrit. Par exemple, Jung, dans son essai « Un mythe moderne » (« Ein Moderner Mythus », 1958), voulait voir dans la forme des soucoupes volantes celle d’un mandala, interprétant l’ensemble du phénomène comme l’expression d’une angoisse psychique collective. Les mandalas et autres ennéagrammes — terme dont l’invention est attribuée à Gurdjieff (1877-1949), soit dit en passant — découverts par le professeur Aberlour fonctionnerait dans le sens inverse de celui décrit pas le psychiatre suisse : au lieu de constituer des émanations de l’esprit humain ou de l’inconscient collectif cherchant à s’extérioriser, les signes en question, produits artificiellement, agiraient sur l’esprit du sujet lorsqu’ils sont observés par ce dernier. Un aspect qui rapprocherait Jung d’Aberlour est cette idée que les « races » pourraient posséder des psychés différentes. Dans une « Introduction » au recueil d’essais « Jung and the Shadow of Anti-Semitism » (Nicholas-Hayes, 2002), édité par Arieh Maidenbaum, le Dr. Stephen A. Martin rappelle que :« […] en 1928, [Jung] répondit directement à l’accusation persistante d’antisémitisme en déclarant que toutes les races, bien qu’ayant un point d’origine collectif commun, se différencient et développent des caractéristiques essentielles spécifiques et qu’aucune de ces caractéristiques n’est valide de manière générale pour tous les autres groupes. Percevoir et reconnaître ces différences, dit-il, ne signifie pas être antisémite. » (p.XXI)
Pour que la bombe iconique puisse fonctionner correctement, en épargnant les « bonnes » populations (ou races), il faudrait que l’hypothèse de Jung soit justifiée : non seulement l’humanité pourrait se découper en différentes races, ainsi que le voudrait la « raciologie », dont l’anthropologue allemand Ernst Günther (1891-1968) fut un des principaux promoteurs, mais encore, à chaque race, correspondrait une structure psychique particulière, innée, qui la distinguerait radicalement des autres. On se rappelle l’allusion, faite par un informateur de Callixte Longtun, aux « fondamentaux », aux « racines », et plus précisément à « la triade prêtre/guerrier/paysan », chère aux amis du professeur Aberlour : référence à la fameuse théorie des fonctions tripartites indo-européennes avancée par Georges Dumézil dans le domaine de la mythologie comparée, structure sociale qui serait considérée par Aberlour comme une des prétendues « signatures culturelles » caractéristiques des peuples sains à épargner… L’historien des religion n’aurait sans doute guère apprécié ce patronage involontaire.
Dans le cadre du roman de L.L. Kloetzer, l’effet pandémique du « Satori » se fait sentir sur une échelle apparemment plus large que prévu, comme l’explique Yvan Legorre :
« Reste une chose. Les ingénieurs de Tirzi, ces pauvres gens que nous avons exécutés au bord de la route, vous souvenez-vous ? J’avais tu une chose, dans mon rapport.
Plusieurs d’entre eux étaient malades. Européens, bien blancs. Porteurs lents. Le filtrage sociogénique ne fonctionne pas. » (p.110)
Mais le porteur de la bombe iconique ajoute immédiatement :
« Darsonval se trompait ? Je ne crois pas. Il savait. Il voulait juste se débarrasser de toute la raclure. Toute. » (p.110)
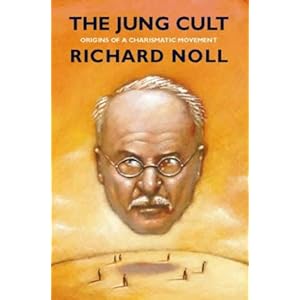 On peut donc tout à fait supposer que le « filtrage sociogénétique » fonctionne, mais qu’il a été réglé pour écumer beaucoup plus « large » que prévu, suite à une décision de la secte d’Aberlour, dont on ignore, au fond, la les intensions ultimes : jusqu’à quel point la secte comptait-elle contrôler l’ouverture de la boîte de Pandore ?
On peut donc tout à fait supposer que le « filtrage sociogénétique » fonctionne, mais qu’il a été réglé pour écumer beaucoup plus « large » que prévu, suite à une décision de la secte d’Aberlour, dont on ignore, au fond, la les intensions ultimes : jusqu’à quel point la secte comptait-elle contrôler l’ouverture de la boîte de Pandore ?On peut aussi signaler que, dans deux essais pour le moins controversé, « The Jung Cult, Origins of a Charismatic Movment » (1994) et « Jung, le Christ aryen » (« The Aryan Christ : the secret life of Carl Jung », 1997), l’écrivain et psychologue Richard Noll a insinué que le psychiatre suisse aurait plus ou moins secrètement ambitionné de créer une religion : un point de rapprochement supplémentaire, même si polémique, entre le professeur Aberlour et le théoricien de la psychologie des profondeur…
Un roman policier de science-fiction dans un monde saturé
« Anamnèse de Lady Star » peut être vu, au moins partiellement, comme un roman policier d’investigation, dans lequel les processus et techniques d’enquête — du futur — utilisés par les policiers se trouvent décrit avec une extrême précision. Le chapitre le plus impressionnant à ce niveau me semble « Marguerite. Chypre, 52 ans après le Satori ». Magda Makropoulos y interroge un témoin important, Jamie Klein, lieutenant de marine à l’époque où débutent les travaux de la commission de Kanazawa, à l’occasion de laquelle une cour de justice spéciale, présidée par le professeur Jiro Izu, se trouve chargée de faire toute la lumière sur le « Satori », puis de juger et condamner les responsables. Jamie Klein, « rattaché à l’organisation des Nations Unies pour la sauvegarde culturelle » se trouve chargé, dans le cadre de l’opération « Mémoire », de remettre en mains propres à Jiro Izu des cubes renfermant toutes les données connues sur le « Satori ». L’enquêtrice soupçonne que ces données ont, à moment donnée et à l’insu de l’officier, été trafiquées par Hypasie, laquelle aurait pour l’occasion adopté une nouvelle identité, celle de Marguerite (ou Maagareto Furasawa, déformé à la japonaise). Superbe trouvaille de L.L. Kloetzer, son enquêtrice utilis une méthode de reconstitution futuriste, qui consiste à s’immerger, au sens propre, dans la scène d’enquête, entièrement reconstituée à partir de toutes les données disponibles et d’algorithmes extrapolant sur la probabilité ou la plausibilité de tel ou tel élément non assuré. Ce qu’il faut bien comprendre, et ce qui en fait tout le sel, c’est que dans ce système, l’enquêtrice se retrouve elle-même à jouer le rôle d’un des personnages clés :
« Veuillez vérifier vos paramètres vitaux : rythme cardiaque, tension, fréquence respiratoire.
Assurez-vous que rien ne vienne entraver vos vies aériennes supérieures.
Assurez-vous de la disponibilité d’une personne extérieure susceptible de vous venir en aide en cas de malaise.
Magda ferme les yeux pendant les avertissements de sécurité. Elle n’a jamais pris le temps de chercher le truc permettant de les passer complètement. Une minute complète de bla-bla à chaque connexion. Insupportable.
Elle a tiré son matelas par terre pour ne pas risquer de tomber du lit. À bien fermé les fenêtre, hors de question qu’un chat vienne lui pisser dessus, comme l’autre fois. Et, à propos de pisser…
[…] Elle flotte dans un liquide noir et tranquille. Les derniers mots s’effacent, la voix intérieures se tait. Défilé de logos, de signes, codes de versions. Compte à rebours. 3… 2… 1…. Immersion.
Elle titube, perte d’équilibre, classique. Les lumières de l’hôtel fluctuent. Elle reprend sa marche, petits pas serrés, elle porte un kimono, très ajusté, elle n’a pas l’habitude mais son avatar sait comment se comporter. Il faut se mettre en retrait, résister à l’envie de tout explorer. Ses pas sont étouffés par la moquette, très épaisse. Elle porte un plateau, très lourd, elle manque de le faire tomber au moment où elle s’en rend compte puis rattrape inconsciemment son erreur. Celui qui la regarde la croira ivre.
Elle a demandé quelques minutes de solitude à Nero au début de la projection, le temps de s’habituer. Elle fixe son attention sur les détails, les lampes, les meubles, les lumières indiquant les sorties de secours. Beau travail, aucune sensation de flou, aucun de ces malaises qui naissent quand l’esprit atteint les limites d’une simulation. Le modèle est bon et son imagination supplée sans problème aux manques de la reconstitution. Une vague lueur orange dans le coin de son champ de vision lui rappelle toutefois qu’elle a désactivé le contrôle ECG — cela fait plusieurs années qu’aucune immersion de ce type n’a plus provoqué d’accident. […] » (p.171-172)
J’ai été bluffé par la maîtrise dont fait preuve L.L. Kloetzer lorsqu’il décrit les subtils tâtonnements de l’enquête, les instants fugitifs où surgissent les incertitudes, les infimes basculements, les accros à peine perceptibles qui viennent troubler la scène et qui dévoilent — peut-être — la présence dissimulée d’Hypasie/Marguerite qui est parvenue à placer Jamie Klein sous son sa dépendance, malgré l’âpre lutte menée par l’officier pour conserver la maîtrise de son psychisme. Une forme supérieure de roman policier d’investigation, du véritable roman policier de science-fiction, serais-je tenté d’écrire : je ne pense pas avoir déjà lu quelque chose du même genre qui soit agencé avec une telle minutie. La compréhension de ces scènes demande, il ne faut pas le cacher, une attention extrême du lecteur. Face aux pièges, aux changements de point de vue, et surtout aux témoignages en gigogne, on peut vite perdre pied. Il faut alors se livrer à un petit saut en arrière, en se maudissant de son inattention. Tout en n’étant jamais certain de tenir toute la vérité : brouiller les pistes est une des raisons même d’exister d’Hypasie. Si elle existe.
Au fil de la lecture, on commence à obtenir une meilleure vue d’ensemble du monde futur dans le quel se déroule l’action, même si les zones cachées ou incertaines demeurent nombreuses, et même si certaines révélations ou renseignements semblent parfois compliquer la donne plutôt que la simplifier. Mais il n’y a aucune raison que l’avenir — que ce soit celui qui nous attend effectivement ou celui d’« Anamnèse pour Lady Star » soit simple, tout au contraire. Ce que l’on comprend de manière évidente, c’est que ce futur est un futur où la notion de vie privée ne possède plus guère de sens. La civilisation a manqué de s’écrouler définitivement du fait de la monstrueuse pandémie, et pour les humains civilisés qui ne sont pas retournés à l’état de sauvagerie en devenant ce que l’on appelle des « porteurs lents » contagieux qu’il faut absolument éviter, une surveillance technologique draconienne et de tous les instants s’avère indispensable. À tout moment, si nécessaire, des moyens d’investigation à côté desquels ceux du « 1984 » de George Orwell relèvent de l’amateurisme émouvant, peuvent être activés, et les indignations immédiatement contemporaines, fustigeant l’espionnage permanent et généralisé des connectés sur et par les réseaux, apparaissent bien dérisoires. Dans ce futur, chaque civilisé est muni de son « egg », sorte de super iPhone qui le maintient en contact avec le reste du monde, mais fournit par la même occasion au reste du monde toutes les données sur le civilisé concerné. S’en offusquer, pour un citoyen de ce temps, n’a guère de sens : la survie de la civilisation est tout simplement à ce prix.
Cette plongée permanente dans le fleuve effarant des données du monde est rendu par L.L. Kloetzer de manière étourdissante. On s’y croit, on y est. On se retrouve en immersion.
« Anamnèse de Lady Star » est aussi le roman de la saturation, au niveau informationnel : du point de vue du lecteur, qui s’efforce de reconstituer, tant que faire se peut, le puzzle du monde, mais aussi de celui de l’enquêtrice, empêtré dans les fils des réalités probables ou réinterprétées, et, en fait, de tous les personnages du roman — Hypasie mise à part, bien entendu (si, ou quand elle existe). Maintenir un moment la tête hors de l’océan informationnel, pour tenter de prendre un minimum de recul, même si bien relatif, sera une préoccupation permanente, à tous les niveaux.

Le gardien de fantômes
De tous les témoins réinterrogée par l’enquêtrice Magda Makropoulos — enquêtrice, mais aussi archéologue, c’est d’ailleurs ainsi qu’elle est professionnellement définie : une archéologue qui fouille et réorganise la gigantesque base de données informatiques de l’opération « Mémoire » —, le personnage que j’ai jugé le plus touchant humainment est Fabrice Herriman. Magda Makropoulos en recueille le témoignage dans le chapitre « Giessbach. Giessbach, 30 ans après le Satori ». L.L. Kloetzer dote ce solitaire d’une personnalité complexe, oscillant sans cesse entre l’introspection et la recherche de l’oubli de soi. Ce déserteur qui, un jour de son errance après le « Satori », échoue dans un hôtel de luxe abandonné, le Grandhotel de Giessbach qui surplombe le lac de Brienz, en Suisse (on murmure d’ailleurs que L.L. Kloetzer entretiendrait des rapports avec ce pays faussement raisonnable qu’est la Suisse…). Alors que la pandémie fait encore rage et que la civilisation s’écroule, il s’improvise en quelque sorte gardien du palace, ou plutôt, une entité qui semble être le « fantôme » d’Hypasie le recrute pour cette tâche :
« Comment avez vous trouvé vos dormants, Fabrice ? J’avais trouvé le Grandhotel à l’orée de l’hiver. C’était trois années après la bombe, il y a pus de vingt ans de cela. Je marchais depuis des semaines, depuis les Grisons, ma compagnie avait été envoyée en reconnaissance dans l’Oberland, en vérité c’étaient tous des dingues. Ils voulaient piller les maisons et s’accaparer des terres, se bâtir un empire minable, régenter les survivants, les survivantes, ils se voyaient en patriarches, avec trois femmes, six femmes, une grande maison et un fusil comme bâton de commandement. Ils ne comprenaient pas la maladie, ils pensaient que leurs psaumes, leur magie évangélique les garderaient du mal. Je les ai abandonnés en pleine nuit, j’ai déserté, je n’ai plus jamais entendu parler d’eux. La régions étaient vide, la population saine avait été rassemblée dans des camps, je ne voulais pas rejoindre ce monde là, je marchais au hasard, comptant sur la chance, espérant peut-être mourir de froid entre les arbres. Je n’ai jamais craint de marcher, j’aime cela, j’avais gardé mon fusil, quelques rations, je ne savais pas chasser. J’allais arriver au bout de mes ressource mais je n’avais pas peur. […] Les portes de l’hôtel jouaient encore sur leurs gonds, j’ai secoué la neige de mes bottes, j’ai été surpris par l’odeur, un parfum d’épices et de fleurs, je les retrouve parfois encore entre les vieux draps, dans les placards pas ouverts depuis des années. […]. Il y avait de la lumière dans le café, une table y était mise, pour deux, bien trop grande, décorée de fleurs de verre et de chandeliers. La lumière des bougies dessinait un cercle, j’ai compris tout de suite sa dimension symbolique. Quelqu’un m’invitait. J’ai eu le choix, j’aurais pu tourner le dos, dormir sous l’escalier, repartir à l’aube et je n’aurais rien vu […]. Je me méfiais, je me disais que cette lumière aurait un prix.[…] Ainsi, j’ai dîné aux chandelles, puis j’ai dormi nu dans une chambre au lit à baldaquin derrière des rideaux fins comme des toiles d’araignées, et quelqu’un est venu me rejoindre et ce qui s’est passé derrière les rideaux tirés je ne sais plus le dire mais je ne pouvais plus repartir car il y avait un prix à payer. Pour le repas, pour la chambre, pour le feu et la lumière, pour une nuit qu’un homme ne peut connaître qu’une fois dans sa vie. J’avais reçu la mission. Dès le lendemain je prenais possession des lieux qui étaient déjà miens, et mes pas dans la poussière recouvraient les traces qu’y s’y trouvaient déjà. » (p.277-279).
On se trouve sans cesse aux lisières du fantastique dans ce chapitre, et plus d’une fois, en lisant le fascinant témoignage du gardien solitaire, je me suis surpris à penser au film mythique de Stantley Kubrick, Shining (1980). L’atmosphère construite par L.L. Kloetzer est par moment oppressante — d’où l’impression de retrouver, d’une certaine manière, celle du chef-d’œuvre kubrickien— avec pourtant des moments de relative détente, ou plutôt de détachement, dans lesquels Fabrice Herriman prend une certaine distance avec la tâche étrange qu’il s’est — ou qu’on lui a — allouée et qui l’amène au bord de la folie. Dans ce témoignage poignant s’insèrent des passages (en italique dans le texte) qui semblent bien constituer des confidences d’Hypasie en personne : c’est dire que, pour le lecteur obsessionnel qui s’acharne à reconstituer le puzzle d’« Anamnèse de Lady Star », ce chapitre s’avère précieux.

Ce que l’on comprend, c’est que Grandhotel de Giessbach a constitué le refuge des survivants de la secte d’Aberlour, fuyant la pandémie mortelle :
« […] ils planifiaient de s’y installer pour adouber les nouveaux membres, pour prononcer les anathèmes contre ceux qui négligeaient la fidélité aux thèses du Maître. Ils étaient mieux placés que quiconque pour savoir ce qui s’était produit à Islamabad, pour comprendre la propagation de la maladie… […] Ils étaient venus avec des hommes armés, des cercueils, leurs documents les plus précieux, les pauvres traces de la maîtrise qu’ils espéraient avoir sur le monde d’après. Ils ne savaient rien, ils étaient dépassés, comme les autres, ils pensaient juste préserver un savoir, une gnose, ils se voyaient comme des êtres spirituels, des prophètes peut-être. […] Ils voulaient fonder une nouvelle école, ils avaient conscience que leur pensée ne survivrait qu’à travers une perpétuation orale, initiatique, dont la base resterait les Entretiens, les discours du Maître, amoureusement recopiés à la main par Lubiano, Papier alcalin, encre métallo-gallique, bons choix pour une préservation optimale, pour les siècle des siècles […] » (p.271-272)
Enfermé dans le coffre de l’hôtel abandonné, le manuscrit des Entretiens sera récupéré par Christian Jaeger en personne, qui déchirera une par une les pages de ce « nid grouillant de serpents » : « Nous devons refermer la boîte de Pandore ». Le bon vieux syndrome du « Necronomicon »…
Si Hypasie prétend avoir été la « servante » de la secte — son discours demeure ambiguë — elle a passé le relais à Fabrice Herriman, chargé de veiller, tant bien que mal, sur les « cercueils » où se sont installés les membres survivants sous la forme de « dormants ». Mais que recouvre ce terme de « dormants » ? Il apparaît tout au long du roman sans qu’une explication définitive soit donnée, et c’est au lecteur de tenter son interprétation, à partir des indices, nombreux mais somme toute pas si explicites. Il semble qu’une partie de l’humanité ait trouvé, comme moyen d’échapper à la pandémie, de se placer dans un état d’animation suspendue — l’état de « dormant » —, en attendant des jours meilleurs. Les corps des « dormants » sont ainsi plongés dans un liquide orange, dont il est dit qu’il assure la survie du « dormant » au moyen de la nanotechnologie. Un minimum d’entretien et cependant nécessaire. Tous ceux gardés par Fabrice Herriman semblent avoir été détruits, entraînant la mort de leurs occupants, soit par l’action des rats, qui ont grignoté les fils d’alimentation en énergie des cercueils, soit par Herriman, dans des accès de violence destructrice : ce n’était pas un si bon gardien… Autre image qui m’est inévitablement venue à l’esprit en pensant aux « cercueils » de L.L. Kloetzer : les caissons d’animation suspendue de « 2001 : A Space Odyssey » (1968), autre film phare de Kubrick. La technologie — imaginaire, jusqu’à nouvel ordre — des caissons de « 2001 » diffère sans doute de celle des « cercueils » d’ « Anamnèse de Lady Star », mais cette notion de sommeil, du suspension de la vie dans l’attente est bien là. Mais l’attente de quoi ?

L’ascenseur pour l’infini
Un dernier coup de sonde. Il en faudrait bien d’autres, pour donner une vision complète (?) du roman. Rien donc sur l’univers ludique et virtuel d’Assur, inventé par Daryl Loomis — où l’on croise Hypasie sous l’apparence d’Hécate, la déesse aux trois visages ! —, ni sur la musique aux relents chamaniques des Norn — comme de bien entendu, j’ai pensé un bon moment que ce trio de chanteuses était une création de L.L. Kloetzer, alors qu’il existe réellement, lamentable manifestation de mes ignorances musicales —, ni sur leur langue imaginaire, ni sur le Festival au relent de cérémonie néo-païenne… Mais cette chronique a dépassé, depuis un moment déjà, la taille du raisonnable.
 Quelques mots sur l’ascenseur spatial, le « Theter ». C’est là un objet technologique impressionnant bien connu des lecteurs de science-fiction et des passionnés de conquête spatiale, depuis « Les Fontaines du Paradis » (« The Fountains of Paradise », 1979) d’Arthur C. Clarke et « La Toile entre les monde » (« The Web between the Worlds », 1979) de Charles Sheffield. Avec l’ascenseur spatial, la conquête de l’espace deviendrait enfin sérieusement envisageable, la dépense d’énergie pour libérer un objet de l’attraction terrestre y étant réduite au minimum. Rien ne s’opposerait plus à la construction de villes de l’espace ou de vaisseaux spatiaux géants. Dans le monde futur d’« Anamnèse de Lady Star », un tel appareillage a été construit… Il y a là une ellipse de taille : comment, dans un monde que vient d’échapper à la l’extermination — la pandémie initié par la bombe iconique est censée avoir fait des milliards de victimes — a-t-il été possible de mobiliser les moyens économiques et technologiques colossaux indispensables à sa réalisation ? Il faudra accepter cette donnée problématique. Tout au plus peut-on imaginer que, dans une vision désespérée, la fuite dans l’espace a été considérée par les puissances dominantes de la planète comme la seule solution définitive aux ravages du « Satori ». On comprend en effet que, depuis des années (un demi siècle ?), la colonisation de l’espace à commencé et que les « Spatiaux », habitant les « Sept Sœurs » — des villes de l’espace ? les autres planète du système solaire ? certains des satellites des dites planètes ? les indications demeurent assez évasives à ce sujet, à moins que ma lecture n’ait pas été assez attentive à ce niveau, ce qui est plus probable… — ont leur mot à dire sur la politique planétaire. Quoi qu’il en soit, Hypasie, qui mène par le bout du nez ses traqueurs depuis le début, a choisi la base du Theter comme ultime refuge, ou, beaucoup plus probablement, comme ultime objectif du plan inconnu qui est le sien. Sous le nom de Moira Finis, elle a su se rendre indispensable à Lead, le maître du « Transfert », un personnage étrange et autoritaire aux allures de gourou et au physique marqué :
Quelques mots sur l’ascenseur spatial, le « Theter ». C’est là un objet technologique impressionnant bien connu des lecteurs de science-fiction et des passionnés de conquête spatiale, depuis « Les Fontaines du Paradis » (« The Fountains of Paradise », 1979) d’Arthur C. Clarke et « La Toile entre les monde » (« The Web between the Worlds », 1979) de Charles Sheffield. Avec l’ascenseur spatial, la conquête de l’espace deviendrait enfin sérieusement envisageable, la dépense d’énergie pour libérer un objet de l’attraction terrestre y étant réduite au minimum. Rien ne s’opposerait plus à la construction de villes de l’espace ou de vaisseaux spatiaux géants. Dans le monde futur d’« Anamnèse de Lady Star », un tel appareillage a été construit… Il y a là une ellipse de taille : comment, dans un monde que vient d’échapper à la l’extermination — la pandémie initié par la bombe iconique est censée avoir fait des milliards de victimes — a-t-il été possible de mobiliser les moyens économiques et technologiques colossaux indispensables à sa réalisation ? Il faudra accepter cette donnée problématique. Tout au plus peut-on imaginer que, dans une vision désespérée, la fuite dans l’espace a été considérée par les puissances dominantes de la planète comme la seule solution définitive aux ravages du « Satori ». On comprend en effet que, depuis des années (un demi siècle ?), la colonisation de l’espace à commencé et que les « Spatiaux », habitant les « Sept Sœurs » — des villes de l’espace ? les autres planète du système solaire ? certains des satellites des dites planètes ? les indications demeurent assez évasives à ce sujet, à moins que ma lecture n’ait pas été assez attentive à ce niveau, ce qui est plus probable… — ont leur mot à dire sur la politique planétaire. Quoi qu’il en soit, Hypasie, qui mène par le bout du nez ses traqueurs depuis le début, a choisi la base du Theter comme ultime refuge, ou, beaucoup plus probablement, comme ultime objectif du plan inconnu qui est le sien. Sous le nom de Moira Finis, elle a su se rendre indispensable à Lead, le maître du « Transfert », un personnage étrange et autoritaire aux allures de gourou et au physique marqué :« Il ressemble à un mort qui marche, sa peau desséchée est creusée de rides, de sillons, de scarifications, les tendons de ses avant-bras et de ses mains sont comme des câbles de transmission robotique, les perfusions et les brûlures ont laissé leur marque, c’est à dessein qu’elles n’ont pas été effacées, car le signe de Saturne doit être porté haut et clair. » (p.426)
(On notera au passage l’allusion assez obscure à Saturne, et le fait que « lead » peut se traduire par « plomb » : usage volontaire, de la part de L.L. Kloetzer, de noms aux connotations alchimiques ? Voilà que rebouclerait bien sur les obsessions de Carl Gustav Jung… Bah, je ne suis plus à une surinterprétation près !)
Sous la direction de Lead, le Tether, « dieu impatient et insatiable », est « nourri toutes les cinquante-cinq minutes de sa ration de cent huit corps humains qu’il élève vers les cieux. » L.L. Kloetzer ne recule pas devant la métaphore religieuse, et l’on se dit qu’il aurait tout aussi bien pu évoquer la fameuse échelle montant vers les cieux, utilisée par Jacob pour fuir son frère Ésaü… Le rôle de Lead ne se borne cependant pas à superviser l’envoi des « cercueils » vers les mondes contrôlés par les Spatiaux. Aidé par des « disciples » (c’est le terme employé), il veille sur le gigantesque réseau constitué par les esprits des millions de « dormants » enfermés dans leurs cercueils. La capacité d’entrer en contact avec les « dormants » et de susciter des « nodes » — autre terme spécifique dont le lecteur tâche de comprendre la signification exacte : j’ai cru comprendre qu’il concerne un type de connexion, passant par l’identification momentané de l’esprit du disciple avec celui du dormant concerné — n’est pas donné à tout le monde : il y a peu d’appelés et peu d’élus pour mener ce travail qui relève visiblement du sacerdoce. Comme par hasard, l’enquêtrice/archéologue Magda Makropoulos va se trouver en mesure de postuler. Est-il utile de préciser que le hasard, dans cet ultime épisode, prend le nom d’Hypasie ?
La réussite d’un livre-monde
Paradoxalement, je pense qu’il faut prendre mes interrogations incessantes et mon incapacité à structurer convenablement cette chronique comme une preuve de l’extraordinaire réussite que constitue à mes yeux « Anamnèse de Lady Star ». J’ai même osé mentionner le titre de « Dune », pour donner un point de comparaison, ce qui a dû sembler présomptueux, voire sacrilège à beaucoup. Pourtant, je maintiens mon appréciation. Il y a quelque chose de « Dune » dans « Anamnèse de Lady Star », parce qu’il s’agit d’un véritable livre-monde, d’un chef-d’œuvre foisonnant et mystérieux dont on sent que l’on arrivera jamais à épuiser toute la richesse. Pire, ou plutôt, mieux, on éprouve l’impression obsédante de passer à côté de certaines aspects fondamentaux, que l’on n’est pas parvenu à discerner à la première lecture, trop occupé à ré-enrouler le fil d’Ariane du labyrinthe : on regarde à ses pieds, et l’on oublie de regarder en haut…
Joseph Altairac








